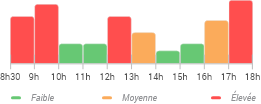Sait-on encore ce qu’est l’amitié ? C’est la question que l’on se pose inévitablement quand on lit des centaines de messages tous plus lénifiants les uns que les autres vantant les mérites de l’amitié, les bienfaits qu’elle est supposée donner, en bref, son utilité. Les réseaux sociaux y sont sans aucun doute pour quelque chose. Les « amis » y pullulent. Pour le meilleur et pour le pire. Pour sortir de ce bougli bougla « amical » qui peut vite devenir indigeste à force d’être sirupeux, dans le meilleur des cas, peut être est il intéressant de faire un détour par ces grands auteurs pour qui l’amitié est un sentiment à la fois inexplicable et d’une grande rareté. D’où la difficulté d’écrire à ce sujet, mais certes pas une impossibilité, même sans l’avoir jamais ressenti, dès lors qu’on en évite les poncifs et les écueils.
L’amitié, c’est quoi ?
L’amitié vue par les dictionnaires
C’est la première question à se poser. Les dictionnaires ne sont pas très aidant. On y sent comme un embarras. Pour Le Robert, par exemple, il s’agit d’un nom féminin dont le premier sens est celui d’un sentiment réciproque d’affection qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l’attrait sexuel. C’est le sens qu’on lui donne notamment dans la phrase : se lier d’amitié avec quelqu’un. Pour ce qui est de son deuxième sens, il s’agit d’une marque d’affection ou d’un témoignage de bienveillance. C’est ce qui ressort des formules d’invitation du type très poli : nous ferez-vous l’amitié de venir ?
Un peu plus prolixe, le Larousse n’est cependant guère plus enthousiasmant. Laissant de côté, la parenté et l’attrait sexuel, il s’appesantit en revanche sur le sentiment d’affection entre deux personnes et donne différents synonymes pour caractériser cet attachement. On y trouve pèle mêle, la camaraderie, la familiarité, l’intimité, la bienveillance, la gentillesse, ou encore la courtoisie. Et ce qui est nouveau, il y ajoute toutes ces relations dites amicales qui peuvent souligner la qualité et la spécificité de relations entre collectivités ou tout simplement entre voisins.
L’amitié vue par Aristote
Etant donné, le bougli bougla de l’amitié, du moins est-ce l’impression que cela peut donner, vue par les dictionnaires, on a peut-être intérêt à se tourner vers les définitions qu’en donnent les philosophes. Et comme le sujet les interroge depuis longtemps, on peut notamment s’arrêter sur ce qu’en a dit Aristote, il y a de cela fort longtemps, vingt cinq siècles pour être précis, ce qui n’enlève rien à son acuité. Bien au contraire.
Il y a consacré les Livres VIII et IX de son Ethique à Nicomaque. On ne va pas se lancer ici dans une analyse de cette œuvre majeure du philosophe grec, ni tenter d’en résumer les raisonnements. Comme de bien entendu pour tout chercheur qui se respecte, Aristote a bien sûr tenu à catégoriser l’amitié, en distinguant trois types d’amitié : l’amitié utile, l’amitié agréable et l’amitié en tant que telle. La seule qui puisse être solide et durable .
Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi l’amitié véritable est-elle si restreinte que les doigts d’une main suffisent largement, dit-on, à compter les vrais amis ? On peut, pour le coup, résumer tout le principe de la vraie amitié selon Aristote en une phrase :
Un bon ami est un ami qui nous élève.
Evidemment, l’assertion renvoie à un autre questionnement, celui de qu’est-ce qui nous élève. Mais, sans savoir ce qui précisément nous élève, on peut avoir une assez bonne idée de ce qui nous abaisse. Sur ce plan, qui est celui de la morale, il n’est pas simple de s’engager, dès lors qu’on n’est plus très sûr, de surcroît, de ce qu’est la vérité.
Il est, par conséquent, intéressant de faire un détour supplémentaire via les grands auteurs de l’amitié et peut-être ceux-ci sauront-ils en définitive nous inspirer pour nos prochains textes dédiés à l’amitié.
Quels sont les grands auteurs de l’amitié ?
Montaigne et La Boétie

Quand on pense aux grands auteurs qui ont écrit sur l’amitié, on pense immédiatement à Montaigne, à ses Essais, et sa phrase fameuse à propos de son ami La Boétie, l’auteur de l’universel « Discours sur la servitude volontaire« . Ecrit à 19 ans ! Pour expliquer cette amitié, il n’a su dire autre chose que ;
Parce que c’était lui, parce que c’était moi.
Autant dire qu’on n’en sait rien et que toutes les suppositions sont possibles. Sauf que lorsque Montaigne s’exprime à ce sujet, La Boétie est mort depuis longtemps et que par conséquent on peut très bien voir dans cette façon de s’exprimer celle qu’on utilise habituellement quand on écrit un tombeau.
En tout cas, l’amitié ne saurait être ordinaire. Du moins, la vraie. Elle se situe même au-delà de ce qu’en a dit Aristote. Elle fait partie d’un monde idéal où elle ne peut croître que si elle bénéficie d’un climat fait d’admiration réciproque, de désintéressement et de stricte égalité.
Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires
Aussi célèbre que la formule de Montaigne, Alexandre Dumas (1802-1870) a rendu immortel son roman historique « Les trois mousquetaires » paru en 1844 avec la phrase bien connue :
Un pour tous, tous pour un
Il ne s’agit plus ici d’expérience vécue, mais de fiction. L’amitié qui y est décrite est une amitié entre quatre mousquetaires et telle que l’on peut en observer dans le cadre de combats. De ce fait, il s’agit plus d’une camaraderie « à la vie, à la mort », forgée, en quelque sorte, au feu des canons que le résultat d’une méditation philosophico-morale.
A coup sûr, elle peut servir de bon guide pour les auteurs cherchant à immortaliser ces moments rares où ils ont pu avoir le sentiment de pouvoir compter absolument sur la loyauté et le secours d’une personne amie.
Correspondances littéraires entre amis
On n’est plus ici dans la fiction, ni dans l’idéal amical, mais dans cet entre soi indispensable entre deux créateurs ayant besoin l’un de l’autre pour apprécier leur œuvre. Difficile de créer quand on est seul. Difficile de créer et de ne pas sombrer dans le désespoir quand on ne croit plus à ce que l’on crée. C’est là qu’interviennent les correspondances littéraires entre amis. Elles ont ce pouvoir de replacer chaque œuvre à sa place.
Correspondance Ludmila Savitzki et André Spire
On ne peut imaginer, en effet, que l’un dénigre l’autre par plaisir de dénigrer, mais on conçoit très bien que l’un s’appuie sur les observations et les critiques de l’autre pour améliorer sa création. C’est ainsi qu’on peut voir la correspondance entre Ludmila Savitzki et André Spire et celle entre Paul Morand et Jacques Chardonne. Pas de définition de l’amitié dans ces correspondances, seulement l’amitié en pratique.

La correspondance entre Ludmila Savitzki et André Spire s’étend de 1910 à 1956. Soit près d’un demi siècle. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une publication sous titrée : une amitié tenace. Si on connait peu Ludmila Savitzki (1881 -1957) traductrice réputée de l’entre deux guerre et « passeur » de nombreux écrivains modernistes, on connait un peu plus André Spire (1868-1966), haut fonctionnaire, poète et ardent défenseur de la cause sioniste.
Correspondance Paul Morand et Jacques Chardonne
Notons qu’André Spire était coutumier des correspondances amicales s’étendant sur de longues périodes, puisque sa correspondance avec cet autre grand intellectuel que fut Daniel Halèvy s’est déroulée quant à elle de 1899 à 1961 et a également fait l’objet d’une publication sous titrée : une amitié à l’épreuve de l’histoire.
Autre contexte, celui de l’après seconde guerre mondiale, autres auteurs de premier plan et une correspondance étincelante faisant revivre le mouvement des hussards, celle de Paul Morand (1888- 1976) et de Jacques Chardonne (1884-1968). Elle s’étend de 1949 à 1968 et a été publiée en trois tomes dans la collection blanche de Gallimard. D’emblée, les deux épistoliers ont voulu faire, sciemment, de leur correspondance une œuvre littéraire à quatre mains et destinée à la postérité sans rien lui cacher de leurs humeurs du moment.
Comment écrire sur l’amitié ?
L’amitié dans les mémoires et les journaux intimes
On le voit avec les trois exemples précédents, écrire sur l’amitié peut se faire de multiples façons. Ce peut être sous la forme de mémoires ou d’un journal intime à la manière de Montaigne.
On peut citer, notamment, sur ce plan, le très célèbre journal intime d’Anaïs Nin (1903-1977) publié après sa mort. Elle y détaille librement ses relations amoureuses et amicales. En particulier, celles qu’elle a entretenu avec de grands écrivains comme Henry Miller, Antonin Artaud ou Gore Vidal.
L’amitié dans les œuvres de fiction
Ce peut être aussi sous la forme d’une œuvre de fiction à la manière d’Alexandre Dumas. Sans être un roman d’aventure, mais plutôt un conte philosophique, une des œuvres de fiction les plus célèbres sur l’amitié est le Petit Prince d’Antoine de saint Exupéry.
C’est par le biais du symbole porté par le renard que l’écrivain y précise en quoi l’amitié ne peut naître qu’après une phase d’apprivoisement réciproque, autrement dit, de création de liens réels. Et quand cet apprivoisement s’est concrétisé on peut alors penser comme La Fontaine dans sa fable « Les deux amis » :
Qu’un ami véritable est une douce chose !
Il cherche vos besoins au fond du cœur :
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même :
Un songe, un rien, tout lui fait peur
Quand il s’agit de ce qu’il aime.
L’amitié dans les correspondances

Ce peut être enfin sous la forme d’un échange épistolier se déroulant sur un grand nombre d’années. On a cité quatre correspondances au long cours, elles ne sont évidemment pas le seules. D’ailleurs, en général, certains des épistoliers mènent en même temps plusieurs correspondances de ce type. C’est notamment le cas d’André Spire.
Si on veut en savoir plus sur ce genre si particulier qu’est le genre épistolier, on peut visiter le site N’oublie pas d’écrire et peut-être y trouver une source d’inspiration parmi les très nombreuses références de correspondances qui ont réussi à passer le cap des années.
Pour notre part, on relève celle concernant Mme du Deffand, brillante épistolière et salonnière du XVIII -ème siècle que l’on peut préférer à Mme de Sévigné et en particulier les lettres publiées sous le titre Correspondance complète de Mme du Deffand avec ses amis.
Comment choisir entre les façons d’écrire sur l’amitié ?
Mais, au final, comment choisir entre les différents tons possibles d’une écriture sur l’amitié ? Tous les genres littéraires lui conviennent. Dés lors, il faut en revenir à soi. Sans se préoccuper, ni s’embarrasser de considérations stylistiques.
Ce qui compte, c’est le respect des valeurs centrales de toute écriture sur l’amitié, c’est-à-dire, son authenticité et sa gratuité.