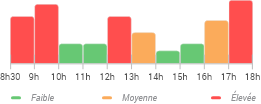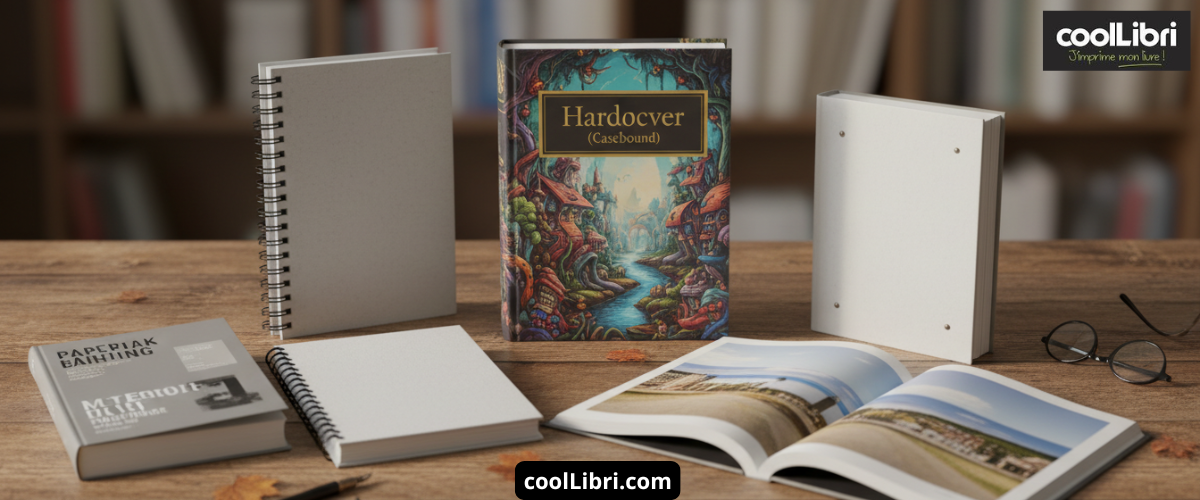Pendant plusieurs siècles, la république des lettres a joué un rôle civilisateur, européen avant la lettre, grâce à ses animateurs qu’ont été les écrivains et les savants. Pour l’essentiel, cette république intellectuelle s’est manifestée de manière épistolière. Née précisément au XIVème siècle, très active pendant tous les siècles suivant, elle n’a donné des signes de déclin qu’à partir du XIXème siècle. Aujourd’hui, si elle existe toujours, ses contours sont plus indistincts et ses manifestations se sont largement diversifiées. De fait, si son rôle au début de la Renaissance était très clair, il n’en est plus tout à fait de même à l’aube du XXIème siècle. Pour autant, il semble bien qu’outre la place éminente qu’elle occupe, quoi qu’il en soit, dans la chaîne du livre, elle puisse retrouver un regain de vigueur à l’occasion des multiples interrogations qui agitent le monde occidental.
Les origines de la république des lettres
On sait de quand date la république des lettres. Elle est née précisément le jour où l’expression a été utilisée pour la première fois. En effet, c’est dans un courrier de remerciement adressé par Francesco Barbaro à Poggio Braccioli, dit le Pogge, qu’on en trouve la première occurrence.

Cette première occurrence de « Republica litterarum » fait suite à un envoi de manuscrits, particulièrement rares, récupérés par le Pogge dans des monastères germaniques.
On en connait la date. C’était en 1417. Et le moment est important. Il a même fait l’objet d’un roman historique, présenté comme un essai littéraire, écrit par Stephen Greenblatt. Celui-ci a été publié par les éditions Flammarion, en 2017.
Quattrocento, de Stephen Greenblatt
Stephen Greenblatt, né en 1943, est critique littéraire et surtout théoricien de la littérature. A ce titre, on peut dire qu’il est le fondateur du néo-historicisme qui en constitue une approche particulière. Diplômé de Yale, professeur de littérature à Berkeley et à Harvard, il considère en effet qu’on ne peut détacher une œuvre du contexte culturel dans lequel elle est née.
Il s’est fait connaître internationalement notamment avec la publication de Quattrocento en 2013 et celle de Will le magnifique, en 2014. Avec Quattrocento, Stephen Greenblatt met donc en scène le moment précis où le florentin Le Pogge (1380-1459), un temps secrétaire de la Curie romaine, auprès du pape schismatique Jean XXIII, et pour cette raison, temporairement sans emploi, retrouve dans un monastère allemand un vieil exemplaire de « De rerum natura » de Lucrèce.
A partir de là, l’exemplaire va être copié et recopié et, du fait de son contenu, très moderne, mettre fin à des siècles de scholastique et ouvrir la voie à la Renaissance. Pour Lucrèce (1er siècle av JC) , en effet, propagateur de la philosophie d’Epicure (IVème siècle av JC), l’univers n’est qu’une combinaison aléatoire d’atomes. Evidemment, tout ce qui est d’ordre religieux pour expliquer l’existence de l’univers en prend pour son grade.
Sans surprise, ce faisant, la diffusion progressive du « De rerum nature » va être le catalyseur d’une nouvelle classe sociale en avance sur son temps qui se qualifie elle-même de République des lettres. Très bien documenté, comme on peut s’en douter, le livre se lit d’une traite comme un roman et fait vivre les débuts de la Renaissance, et donc de la société moderne, de manière remarquable.
La république des lettres, une affaire de lettrés
Comme on vient de le voir, la République des Lettres, c’est d’abord et avant tout la réunion de personnages, particulièrement érudits, appelons les des lettrés, qui partagent une même vision de ce que peut et doit être l’Humanité.
Si leurs opinions peuvent diverger sensiblement, ils s’accordent néanmoins sur un principe fondamental. Cette vision doit être libérée de tout dogme et se fonder sur la science et ses observations.
Pour faire avancer leur cause, ils correspondent entre eux par lettres pour échanger leurs trouvailles et leurs opinions. Les lettrés sont nés. Depuis lors, ils ne cesseront de dominer la scène intellectuelle du monde occidental.
Tout lettré est un érudit
Un lettré authentique se caractérise par trois signes : son érudition, sa maîtrise des humanités et son amour des livres.
Le dictionnaire Le Robert donne de l’érudition la définition suivante :
Savoir approfondi fondé sur l’étude des sources historiques, des documents, des textes.
Autrement dit, l’érudition est beaucoup plus vaste que le seul savoir scientifique. Elle ne constitue pas un savoir particulier situé à part de bien d’autres. Elle correspond à une attitude face au savoir en général.
De fait, une attitude érudite compose avec tous les grands domaines d’études et ne s’exprime sur un sujet qu’en ayant mené, au préalable, une recherche documentaire qui exclut, au minimum, tout ce qui s’apparente à un préjugé ou à un dogme.
Un lettré a fait ses humanités
Pour ce qui est des humanités, les dictionnaires ont du mal à s’accorder sur une définition commune. Ils en oublient facilement le « s » final et verse alors dans l’évocation d’une attitude bienveillante et pleine d’indulgence.
A la mode ancienne, les humanités, c’est autre chose. C’est en premier lieu, comme l’indique le dictionnaire Larousse, en précisant bien que c’est un vieux terme :
L’étude de la langue et de la littérature grecque et latine.
A cette aune là, on comprend bien que si la maîtrise des humanités était un passage obligé à l’époque de la Renaissance, elle ne l’est plus du tout aujourd’hui. Mais, rien n’empêche de se libérer de ce carcan restrictif.
Ce qu’ont fait un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur bien contemporains comme, par exemple, l’Ircom. Celle-ci se définit d’ailleurs comme l’école supérieure des Humanités et du Management, fondée en 1984, à Angers.
Elle propose même une licence d’Etat, délivrée après trois ans d’études dans le cadre d’une convention avec l’Université d’Angers intitulée « Humanités et Science politique ».

Un lettré aime les livres
C’est l’amour des livres qui a ouvert le chemin à la Renaissance et a mis fin à des siècles de dogmatisme fondé sur l’étude d’un seul livre, le Livre, autrement dit, la Bible. C’est cette rupture que met en exergue l’essai historique de Stephen Greenblatt.
Cet amour des livres qui peut se traduire en bibliomanie et en bibliophilie dés qu’il franchit un certain niveau est le marqueur absolu de tout lettré. A tel point qu’il est courant d’opposer lettré et homme d’action.
De ce point de vue, la lecture ne pourrait pas faire bon ménage avec les nécessités du quotidien qu’il soit domestique ou professionnel. Opposition, en réalité factice comme peuvent le montrer de nombreux exemples.
Didier Pineau-Valencienne, le grand capitaine d’industrie qui a su faire d’un conglomérat hétéroclite un groupe mondial de premier plan était un lettré dans tous les sens du terme. Il décrit fort bien son parcours dans deux ouvrages riches de sens « Dans la boucle de l’hirondelle, Mémoires d’entreprise » et « Soleil et sympathie ».
Et il est loin d’être le seul dans ce cas. On peut même dire quand on prend la peine de s’intéresser à ce parcours que c’est sans doute parce que Didier Pineau Valencienne était un lettré, et même un fin lettré, qu’il a su faire ce qu’il a fait.
En travaillant intelligemment, aimait il à dire, on est capable de vaincre ce qui apparait trop souvent comme une fatalité.
Notons, enfin, pour clore ce chapitre que l’écrivaine Marguerite Yourcenar a parfaitement bien analysé ce rapport entre le fait d’être à la fois lettré et homme d’action dans son roman intitulé Mémoires d’Hadrien » qui constitue sans doute son œuvre majeure.
L’âge d’or de la république des lettres au sens strict
L’âge d’or de la république des lettres est indiscutablement celui des salons. De ce qu’on appelait salon au XVIIIème et XIXème siècle. Bien qu’étant lié par les mêmes goûts et les mêmes habitudes, du moins celles des gens de lettres, les deux périodes sont bien distinctes. Si la première en a vu l’apogée, la seconde a signé sa quasi disparition.
La république des lettres, une émanation des salons et des salonnières de l’Ancien Régime
Les salons, ce sont ces lieux de rencontre où les plus beaux esprits de l’époque lisent leurs derniers écrits, discutent du monde comme il va et comme il devrait aller, dînent ou déjeunent, le cas échéant, le tout sous la houlette de la maîtresse de maison, ou comme on disait en ce temps là, sous celle de la salonnière.
Après l’apparition de la première occurrence « république des lettres », les choses n’en sont pas restées là. Elles se sont développées à la vitesse suscitée par les curiosités insatiables des hommes et des femmes de la Renaissance. Vitesse encore démultipliée avec la généralisation de l’imprimerie.
Mais, après cet essor remarquable, c’est au dix huitième siècle que la république des lettres gagne, si on peut dire, ses lettres de noblesse. Quant à sa composition, elle est intimement liée aux salons qui en font la pluie et le beau temps.

Une république des lettres dominée par quelques grandes personnalités féminines
Quelques noms connus et moins connus émergent comme celui de Mademoiselle de Scudéry (1607-1701), la première lauréate du grand prix de l’Académie française, ou encore ceux de Madame du Deffand (1696-1780), de Ninon de Lenclos (1620-1705), de la marquise de Sévigné (1626-1696) ou de Madame Helvétius (1722-1800).
A noter que certaines d’entre elles ne se contentaient pas d’être de brillantes animatrices, elles étaient aussi de formidables épistolières ou romancières. On pense naturellement à Madame de Sévigné et à ses célèbres lettres, mais elle n’était pas la seule. La correspondance de Madame du Deffand, par exemple, est tout aussi brillante, voire même davantage.
Elles sont ainsi au moins une bonne douzaine à pouvoir, ou vouloir, se dire « reine de Paris », car ces salons sont essentiellement parisiens. Ce qui n’empêche pas qu’ils soient copiés à tout va dans les capitales de province. Et à l’étranger ! En effet, la France, à cette époque, fait figure de première puissance mondiale. Celle qui donne le ton au reste de la planète.
Mais pour conclure cette évocation, disons que ce sont, sans nul doute, ces salons qui ont ouvert la voie à la Révolution de 1789. En effet, ils ont été des lieux on ne peut plus propices à l’épanouissement des idées développées par les philosophes des Lumières. Tels que, entre autres, Voltaire (1694-1778), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Diderot (1713-1784) ou Montesquieu (1689-1755).
A la question qu’est-ce que la philosophie des Lumières, Emmanuel Kant (1724-1804) répondra pour sa part de la manière suivante :
Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières.
Le conseil vaut encore pour aujourd’hui où des bataillons de censeurs sont toujours prêts à se lever pour dicter ce qu’il est bon de penser et de ne pas penser.
La république des lettres à l’époque contemporaine
Une république aux contours flous
Aujourd’hui, on ne parle plus guère de république des lettres, si ce n’est, parfois, avec un brin de nostalgie dans la voix. Est-ce à dire qu’elle a disparu ? Peut-être de « corps », mais pas « d’âme ». De fait, elle existe toujours, mais elle a changé de forme. Elle s’est tout simplement adaptée et mise au goût du jour.
Une république des lettres toujours active
La république des lettres d’aujourd’hui, c’est celle qui réunit les communicants, les membres des multiples cercles culturels, les rédacteurs des médias du « village global ». Rappelons que la notion de village global est une expression qui date des années 70.

Elle a été utilisée pour la première fois par le théoricien de la communication, Marshall MacLuhan (1911-1980) dans son ouvrage « Understanding Media » et notamment dans son premier chapitre intitulé « Le médium est le message ».
En bref, en raccourcissant les distances, les médias ont transformé la planète en un village global où chacun peu parler à chacun pratiquement en temps réel. Comme dans un village.
De ce fait, encore mieux qu’à l’époque de la Renaissance, en tout cas, plus facilement, les membres de cette république des lettres nouvelle manière peuvent partager grosso modo des valeurs et des espérances communes.
Cependant, ce ne sont plus à proprement parler les représentants d’une république des lettres, mais plus globalement, apparemment plutôt ceux d’un Etat de droit, pour ce qui est des règles définissant les modalités du vivre ensemble et ceux de la bien-pensance, pour ce qui est du cadre éthique dans lequel il semble que toute production culturelle se doit de s’inscrire. L’un et l’autre constituant pour finir un air du temps qui peut paraître indépassable.
Cette situation n’est évidemment pas sans incidence sur le travail des écrivains. En effet, elle définit nombre de politiques éditoriales qui elles-mêmes sont « accros » aux désiderata et aux modes des jurys des principaux prix littéraires.
Lesquels, eux-mêmes, sont dépendants des désiderata et des modes des différents cercles dans lesquels ils évoluent. C’est la raison pour laquelle si la républiques des lettres d’aujourd’hui est toujours agissante, et peut-être même plus que jamais, ses contours restent flous et ses acteurs peuvent être difficiles à identifier.
Une république où il est prudent de réserver ses jugements
Une des principales conséquences de cet état de fait est que, dans ces conditions, la liberté d’expression peut y être singulièrement malmenée. On peut donc avoir intérêt à s’inspirer d’une pratique largement utilisée en son temps par un célèbre critique littéraire : la suspension de jugement ou le jugement réservé.
La technique littéraire a été mise au point par le grand critique littéraire qu’a été John Cowper Powys (1872-1963). Il l’a d’ailleurs théorisé dans un ouvrage intitulé justement « Les jugements réservés ».
Selon John Cowper Powys, on ne peut vraiment bien rendre compte d’un auteur que si on parvient à se mettre à sa place et à en épouser toutes les sensations. Comme si en quelque sorte, on en était « possédé ».
Ce qui n’est possible que si on s’interdit de surimposer ses propres jugements sur ceux de l’auteur dont on rend compte. L’analyse peut alors prendre toute son ampleur en devenant volontairement dithyrambique.
De ce point de vue, il n’y a plus de mauvais auteurs, mais des auteurs qu’on aime inconditionnellement et dont on veut faire partager les raisons pour lesquelles on les aime de cette façon.
Ce faisant, on s’affranchit des diktats du moment de la république des lettres 2.0 et on retrouve une certaine marge de manœuvre pour s’exprimer librement. C’est l’autre qui parle, auteur ou personnage, et non plus soi. Du moins, en principe.
Les lettrés sont-ils finis ?
Cependant, peut-être au fond la principale différence entre la république des lettres des origines et la république des lettres contemporaine est-elle, non pas dans sa diversité et le nombre de ceux qui prétendent y appartenir, mais dans leur qualité.
On peut quasiment affirmer qu’au moment où Le Pogge redécouvre l’œuvre de Lucrèce et s’empresse de la diffuser auprès de ses pairs, tous pouvaient être considérer comme des lettrés. C’est-à-dire en l’occurrence des érudits.
Erudits et lettrés pouvaient alors être considérés comme deux mots synonymes. Or, d’évidence, ceux-ci ne constituent plus qu’un petit noyau de la république des lettres 2.0.
Ce qui pose la question de savoir ce qu’est un lettré aujourd’hui et à quoi ce lettré peut bien encore servir. On a vu plus haut ce que sont les lettrés à l’origine. Ils lisent, ils écrivent des lettres, ils parlent latin et grec, ils partagent un même idéal. Cet idéal c’est celui de la Renaissance à ses débuts.
Comme l’écrit Xavier Patier dans son livre sur le château de Chambord qui en est le manifeste architectural le plus pur :
Le Moyen âge n’étant plus, l’ère moderne n’étant pas encore, l’homme est libre.
Où sont les lettrés de la république des lettres 2.0 ?
Même si on peut dire quelque chose de semblable sur le moment contemporain, il semble néanmoins que les lettrés authentiques s’y fassent bien rares. En effet, dans la république des lettres 2.0, il n’y a plus guère d’amateurs des humanités et encore moins de pratiquants des langues dites mortes.
Y a-t-il encore des lecteurs, il semblerait que oui vu la croissance régulière du nombre de volumes imprimés. Mais ces volumes imprimés s’adressent ils vraiment à des lettrés au sens où on peut encore l’entendre. Pas vraiment.
D’autant que le marché de l’écrit est de plus en plus dominé par les ChatGPT, DeepSeek, Grok 2 ou 3 et autres IA de dernière génération qui se livrent une guerre sans merci pour s’en emparer à leur seul profit.
Ce qui convient plutôt bien à des lecteurs pressés et cherchant des réponses précises à des questions utilitaires. Ou encore à des lecteurs à la recherche de simples argumentaires confortant leurs points de vue idéologiques.
Finalement, bien peu à des lecteurs soucieux de creuser leur sillon et leur réflexion dans l’océan de mots qui tend à les submerger chaque jour. Mais, la magie d’internet opérant, ce petit nombre, à y regarder de près, se révèle bien plus important que ce qu’on pourrait penser de prime abord.
Les communautés de lecteurs sont-ils les incubateurs de lettrés 2.0 ?
Clubs de lecture, plateformes d’écriture, concours d’écriture, forums, colloques, salons, blogs spécialisés, autoédition, etc., autant de formules, parmi d’autres, qui toutes reposent sur l’existence d’une communauté de lecteurs permettant de libérer la parole, d’échanger des points de vue et de jouer un rôle finalement très proche de celui des lettrés de la Renaissance et de ceux qui leur ont succédé jusqu’au milieu du XXème siècle. Celui d’une avant-garde dans le domaine de la pensée.
Clubs de lecteur, ateliers d’écriture, plateformes ou forums d’écriture en ligne
On regroupe ensemble ces différentes formules bien qu’elles n’aient pas du tout les mêmes objectifs. Mais si on fait néanmoins ce regroupement c’est que ceux qui s’y retrouvent ont énormément de points communs. Ceux qui appartiennent aux premiers parlent des livres qui les passionnent, les autres veulent les écrire.
Quoi qu’il en soit, tous sont d’infatigables défenseurs ou promoteurs des lettres. A noter pour ce qui est des plateformes ou des forums d’écriture, les procès y sont certes moins didactiques que dans les ateliers animés par des professionnels de l’écriture, mais ils y sont tout aussi instructifs.
Ce ne sont pas les utilisateurs de Wattpad, de l’Atelier des auteurs, ex-Scribay, racheté par Editis, de plume en plume, de Scribbook, de Shortedition ou encore de Wikipen qui diront le contraire. On ne présente plus la première qui regroupe près de 100 millions de lecteurs et d’écrivains à travers le monde.
Qui dit mieux ? Et qui peut dire qu’il n’y a plus de lettrés ? Evidemment, ce ne sont plus tout à fait les mêmes qu’autrefois.
Concours d’écriture
A ces diverses formules on peut ajouter sans conteste les innombrables concours d’écriture. Ils se situent bien dans leur continuité en privilégiant des productions achevées et non publiées. Autrement dit, c’est le paradis des manuscrits et l’occasion pour leurs auteurs de faire un tour de piste éditorial et de se confronter sans trop de peine, ni trop de risques, à leurs pairs, lettrés, au sens large, comme eux.
Ces concours sont organisés par toutes sortes de structures, dont beaucoup sont publiques. Naturellement, qui dit concours dit cadre obligé. Mieux vaut en avoir examiné le règlement dans le détail avant de se précipiter sur la fiche d’inscription correspondante. Souvent gratuite, ce qui ne gâte rien.
Cela dit, une participation bien ciblée peut faire sortir avantageusement un manuscrit de l’anonymat qui est son lot le plus habituel. On ne saurait donc trop conseiller de se tenir régulièrement informé du lancement des concours où il est susceptible de figurer en bonne place. Le site textes à la pelle s’en est fait une spécialité.
Forums, colloques et salons

Les occasions de rencontre ne manquent pas dans la république des lettres 2.0. Les plus accessibles au grand public sont les salons littéraires. Des plus petits, animés par des sachants, comme les cafés littéraires, aux grosses machines comme les festivals du livre dont le festival du livre de Paris est la figure de proue, les lettrés 2.0 comme les plus traditionnels sont à l’honneur comme jamais ils ne l’ont été depuis leurs origines.
A les voir arpenter en nombre les allées des grandes foires du livre, se serrer pour assister à des conférences réunissant des auteurs en vogue, nul doute que la république des lettres dont ils font indéniablement partie est bien vivante.
Et ce n’est pas tout. pour les plus engagés d’entre eux, salons et forums se transforment en colloques faisant l’objet de communications et dressant évènement après évènement un état de l’art, toujours évolutif, sur telle ou telle section du champ littéraire et plus généralement du savoir. Ce qui est bien la finalité ultime recherchée par tout membre de la république des lettres. Qu’elle soit d’hier ou d’aujourd’hui.
Blogs spécialisés
A côté de ces lieux d’échange entre lettrés, il en existe d’autres qui ont l’avantage d’être permanents et interactifs. Ce sont les blogs spécialisés. Des observateurs avisés de leur univers en dénombrent pas moins d’une cinquantaine d’une très bonne facture et, à coup sûr, dotés d’une certaine influence. La plupart n’ont pas d’autre ambition que de faire partager la passion de leur auteur au plus grand nombre possible de lecteurs et d’abonnés.
Citons, entre autres, Alice qui officie sur ça sent le book, Solène de la rousse bouquine ou encore Juliette de la petite plume. Toutes trois sont des passionnées et ont à cœur chacune de faire découvrir à leurs abonnés des contrées littéraires laissées en friche par les médias traditionnels. Les bonnes surprises y sont légion et pratiquement garanties.
Cela dit, les posts ne sont pas toujours récents, mais quelle importance finalement, un livre reste un livre, qu’on l’ait commenté hier ou il y a plusieurs mois. Et puis, surfer sur les multiples blogs littéraires, jusqu’à trouver celui qui vous va comme un gant ou une paire de lunettes, est toujours un vrai régal.
Autoédition et petites maisons d’édition
Dernière occasion notable de rencontre entre lettrés 2.0, les plateformes d’autoédition comme CoolLibri et les petites maisons d’édition. Ce sont des lieux de libre expression en plein essor.
Plus particulièrement, les parutions autoéditées sont en hausse sensible et l’offre de services destinée aux auteurs autoédités ne cesse de se diversifier pour mieux répondre à leurs attentes.
Notons, ce qui est un signe qui ne trompe pas, que la chanteuse à succès Taylor Swift a d’ailleurs annoncé que le livre qu’elle s’est décidée à écrire prochainement serait autoédité. Sans doute la meilleure façon d’écrire sans avoir de compte à rendre à personne.
Quant aux petites maisons d’édition, elles sont plus de 2500 à ce jour et conscientes des enjeux qu’elles représentent, 400 d’entre elles ont adhéré à la fédération des éditions indépendantes récemment créée pour accroître leur visibilité tant auprès des pouvoirs publics que des lecteurs et des auteurs.
Elle édite un journal numérique trimestriel, le petit journal, qui est une vraie mine d’informations sur la chaîne du livre et un lien de plus non négligeable entre ses différents acteurs.
République des lettres, une réalité ou un fantasme ?
En conclusion, si on cherche aujourd’hui une république des lettres comme elle a pu être de la Renaissance à quasiment le milieu des années 50, soit quand même pendant plus de 500 ans, on ne peut que conclure à sa disparition pure et simple. Les lettrés qui la composaient alors quasi exclusivement, s’ils existent toujours, ne sont plus en nombre suffisant pour la constituer et en assurer la survie.
De fait, ils sont mêlés à tout un ensemble de profils parfois très éloignés de ce qu’ils sont qui les supplantent en nombre et en intentions. Cependant, l’ensemble qu’ils constituent les uns avec les autres n’est ni neutre, ni insignifiant. Indiscutablement, ils règnent sur le monde des idées et des savoirs, favorisent l’émergence de nouveaux talents ou au contraire les brident et les empêchent de prospérer.
Compte tenu des moyens et des ressources dont ils disposent, largement supérieurs à ceux dont ont pu disposer leurs lointains prédécesseurs, on peut considérer qu’ils sont tous, chacun à leur mesure, les piliers d’une république des lettres 2.0. Suivant les moments, tels acteurs prédominent sur les autres, mais d’une manière ou d’une autre, ils ne s’écartent guère de ce qu’on peut appeler l’air du temps.
En bref, la république des lettres existe toujours, plus que jamais même, à l’époque du village global, et suivant les quartiers auxquels on peut s’intéresser son noyau dur de lettrés au sens strict est quoi qu’il en soit plus vivant que jamais.
Reste une dernière question à se poser. La naissance de la république des lettres a été à l’origine d’un bouleversement civilisationnel majeur, en sera-t-il de même avec la république des lettres 2.0 ? On peut finalement le penser, En tout cas, les multiples tentatives pour l’encadrer n’auront pas plus de succès que les précédentes.