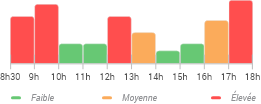L’italien est une langue magnifique.
Une langue qui chante. Une langue qui raconte. Une langue qui laisse vibrer chaque syllabe comme une note tenue.
Et pourtant… lorsqu’on observe les chiffres, on réalise vite qu’elle n’a pas l’immensité démographique des géants mondiaux.
Environ 70 millions de locuteurs natifs. Une goutte d’eau, si on la compare aux centaines de millions d’anglophones disséminés sur la planète.
Mais ce chiffre, à lui seul, ne dit pas tout.
Car il existe une autre Italie. Une Italie de cœur, d’adoption, de passion. Celle de ceux qui ont appris la langue en seconde langue, par amour de sa musicalité, par fascination pour sa culture, par désir d’entrer dans sa littérature.
Avec eux, on atteint près de 125 millions de locuteurs.
Et là, quelque chose devient évident : on ne parle plus seulement d’une langue. On parle d’un univers. D’une sensibilité. D’une tradition littéraire forgée au fil des siècles, avec une identité forte, profonde, assumée.
Oui, on peut parler d’une littérature italophone. Singulière. Cohérente. Vivante. Portée par une communauté qui dépasse largement les frontières et les statistiques.
Parce qu’au fond, la force d’une littérature ne se mesure pas seulement au nombre de voix qui la parlent, mais à l’intensité de celles qui l’écrivent et à la fidélité de celles qui la lisent.
Et pourtant… qu’on les compte à 70 ou 125 millions, les italophones restent minoritaires à l’échelle mondiale. Moins encore si l’on regarde du côté des distinctions internationales : trois lauréats italiens du prix Nobel sur 115 attribués depuis sa création.
À ce niveau strictement quantitatif, on pourrait croire que la littérature italophone est marginale, qu’elle pèse peu face à d’autres traditions plus peuplées ou plus visibles.
Il n’en est rien. Absolument rien.
Car cette marginalité apparente ne reflète en rien le poids immense de la littérature italienne dans l’histoire du monde. Ni son influence colossale. Ni sa place fondamentale dans la construction de la civilisation littéraire occidentale.
Il suffit de prononcer quelques noms : Dante, Boccace, Pétrarque, Marco Polo, Machiavel, l’Arioste, l’Arétin, le Tasse, Casanova, Manzoni… pour comprendre la dette que porte encore aujourd’hui la littérature mondiale envers l’Italie.
Du XIIᵉ au XVIIIᵉ siècle, ces voix ont façonné notre imaginaire, modelé nos récits, inspiré nos arts. Pas un auteur occidental qui, d’une manière ou d’une autre, ne s’y soit abreuvé.
Mais qu’en est-il des cinquante dernières années ? Comment identifier les nouvelles figures majeures, les œuvres qui marquent leur époque, les auteurs qui portent aujourd’hui la flamme italophone ?
La littérature italienne n’est plus aussi dominante qu’elle a pu l’être dans les siècles passés, mais elle reste foisonnante, féconde, extraordinairement vivante. Une littérature d’exploration, d’introspection, de modernité. Une littérature qui continue à surprendre.
Alors, comment choisir ? Comment dresser une liste des dix auteurs italophones les plus marquants de ces cinq dernières décennies ?
Trois critères ont été retenus. Simples, mais exigeants :
- Les grands prix, nationaux ou internationaux, reçus par chacun d’eux.
- Leur diffusion en français dans des collections ou maisons d’édition prestigieuses.
- La dimension contemporaine de leurs thèmes et de leurs regards.
C’est à la croisée de ces trois lignes que se dessine la liste des dix auteurs qui ont marqué — et continuent de marquer — la littérature italophone moderne.
Les grands prix de la littérature italophone
La France a ses grands prix comme le Goncourt, le Fémina, ou l’interallié pour nommer que ceux là sur les six qui constituent la liste des plus prestigieux. L’Italie a les siens, tout aussi prestigieux.
Plus exactement, elle en a 3, chacun avec ses spécificités, très différentes, il faut bien le dire, de celles des prix français.
Prix Bagutta

C’est le plus ancien. Il a été fondé à Milan en 1926 par 2 journalistes, 2 peintres, 1 avocat, 1 comédien, 3 écrivains et 1 dandy. Ils avaient pour habitude de dîner dans le restaurant toscan d’Alberto Pepori, rue Bagutta, à Milan et de parler de leurs lectures respectives. En somme, comme ils auraient pu le faire dans un club de lecture. L’idée de créer un prix littéraire leur est venue un soir de novembre 1926.
La tradition est restée et le jury Bagutta est toujours composé de 10 personnalités choisies pour leur culture et, en principe, sans attache particulière avec le monde de l’édition. Avec le temps, de solides liens se sont établis avec la famille Pepori, toujours propriétaire du restaurant.
Mais aussi avec la Snam Rete Gaz. Cette dernière est une grosse entreprise de distribution de gaz, cotée en bourse, filiale de la Cassa Depositi et Prestiti, elle-même contrôlée par l’Etat italien.
Le prix Bagutta récompense des lauréats dans la catégorie narration, essai, poésie et première œuvre. Pour 2025, il a été attribué à 1 – Vittorio Lingiardi auteur de « Corpo Umano« , publié par la maison Einaudi.
Quant au prix de la première œuvre, il est allé à 2 – Marta Lamalfa, pour « L’isola dove volano le femmine », publié par l’éditeur Neri Pozza. Le roman qui raconte l’histoire d’une famille paysanne implantée depuis plusieurs générations sur la petite île Alicudi, au milieu de la mer Tyrrhénienne, est paru aux éditions Phébus, sous le titre « l’île des femmes qui volent« .
Prix Strega
Créé en 1947 pour relancer les lettres italiennes, le prix Strega est aujourd’hui considéré en Italie comme l’équivalent du Goncourt en France. En tout cas, son impact sur les ventes du livre du lauréat est comparable. Ainsi « L’âge fragile », traduit chez Albin Michel, de 3 – Donatella di Pietrantonio, lauréate 2024, a dépassé les 400 000 exemplaires vendus et deux sociétés de production en ont déjà acquis les droits.
Il faut dire qu’il est né sous des auspices originaux. Strega est le nom d’une liqueur très populaire en Italie. Depuis 1860, elle est fabriquée, dans le plus grand secret, à Bénévent par la famille Alberti. Sa belle couleur jaune d’or que lui donne le safran qui entre dans sa composition est celle qu’on attribue au breuvage des sorcières qui ont fait de Bénévent, paraît-il, le siège de leur confrérie. En tout cas, le « deal » entre la marque et le prix littéraire a incontestablement profité à l’un aussi bien qu’à l’autre.
Aujourd’hui, le Strega n’est plus attribué par le petit groupe d’amis, « les amis du dimanche« , réunis autour de Maria et de Goffredo Bellonci, la première, auteur réputée de romans historiques, comme « La renaissance privée« , Strega 1986, mais par un jury comprenant 400 membres.
Les membres du jury sont toujours appelés les « amis du dimanche « et font partie du monde culturel. Ils choisissent d’abord les finalistes et ensuite le gagnant. Les livres sont proposés par eux-mêmes et chaque titre doit avoir le soutien d’au moins deux jurés. Le prix est remis traditionnellement à l’automne.
Il est animé par la fondation Bellonci, présidée depuis 2017 par Giovanni Solimini, grand spécialiste de la bibliothéconomie. Pour 2025, le lauréat est 3 – Andrea Bajani pour son autofiction « L’anniversario ».
Prix Campiello
Année après année, le Campiello se rapproche du Strega. Certains critiques le jugent même supérieur dans ses choix. Né en 1962 à Venise, le Campiello est le plus jeune des trois grands prix littéraires italophones, mais il bénéficie du soutien très large de tout ce que la Vénétie compte d’entrepreneurs et de riches industriels.
Cette assise unique, le Campiello le doit à une famille et à un homme, Mario Valeri Manera, disparu en 2014 à l’âge de 93 ans. Longtemps président de grandes organisations patronales, celui qu’on a appelé le « Banal Grande » pour souligner son affabilité, a su porter au plus haut de la notoriété nationale et internationale un prix qui aurait pu rester confidentiel.
Cette élévation, le prix Campiello, dont l’étymologie signifie petite place, dont le symbole est la « vera da pozzo », comme il y en a beaucoup à Venise, la doit à sa formule originale de désignation de son lauréat. Celle-ci se fait en deux étapes.
Dans un premier temps, un jury professionnel établit une liste de 5 livres, en principe narratifs, qui devient alors la sélection Campiello. Mais, surtout, dans un deuxième temps, cette sélection est soumise au vote de 300 lecteurs représentatifs de toute la société italienne. A la suite de leur vote, le lauréat reçoit son prix lors d’une cérémonie au Palais des Doges ou à la Fenice.
Le lauréat 2025 est 4 – Wanda Marasco pour son roman « Di spalle a questo mundo« , publié par la maison Neri Pozza.
8 grands auteurs incontournables de la littérature italophone
5 – Primo Levi (1919-1987)

Aujourd’hui, « monument » incontournable de la littérature mondiale, Primo Levi ne se destinait pourtant pas à être écrivain, mais chimiste. Et, c’est en tant que chimiste que Primo Levi a passé les premières années de sa vie d’homme. Son premier livre, « Si c’est un homme » qui décrit de manière quasi clinique son expérience comme déporté au camp de concentration d’Auschwitz de février 1944 à janvier 1945, après une brève période de résistance contre le régime fasciste, restera ainsi pendant des années le seul livre qu’il ait jamais écrit.
Publié en 1947, tiré à 2500 exemplaires, l’ouvrage n’eut pas un grand succès. A cette époque, il est vrai que tout le monde préférait ne plus entendre parler de ces horreurs. Il faudra donc attendre 1963 pour que paraisse « La trêve » son deuxième livre. Entre temps, il mène une brillante carrière de chimiste pour le compte de l’entreprise SIVA.
L’univers concentrationnaire comme source d’inspiration
Cette dernière publication lui vaut d’être le premier lauréat du prix Campiello. Il y raconte ses tribulations après sa libération du camp d’Auschwitz grâce à l’armée rouge. A partir de cette date, espérant se libérer également d’une anxiété chronique héritée de son expérience concentrationnaire, il se consacre peu à peu uniquement à l’écriture. En 1966, il est lauréat du prix Bagutta pour ses « Histoires naturelles » et en 1978 du prix Strega pour « La clef à molette« .
Dans ce dernier ouvrage, il y analyse le réconfort que peut apporter la satisfaction du travail bien fait. Il meurt en 1987 à son domicile après une chute dans un escalier. Pour une majorité de critiques, cette chute ne serait pas accidentelle, mais un suicide. Primo Levi ne parvenant pas à surmonter ses traumatismes. Pour d’autres, de plus en plus nombreux, cette chute serait due à un étourdissement provoqué par la prise d’anxiolytiques mal dosés.
6 – Cesare Pavese (1908 – 1950)
De 11 ans plus âgé que Primo Levi, Cesare Pavese et Promo Levi ne s’en sont pas moins croisés à un moment de leurs études. Bien que d’orientations littéraires complètement différentes, ils ont été l’un et l’autre assaillis par les mêmes tourments. On a dit du premier que la chute dans l’escalier de sa maison en 1987 était un suicide, mais pour ce qui est du second, l’idée de se suicider vraiment le taraudait depuis bien longtemps.
Et c’est en pleine gloire, quelques semaines seulement après avoir été récompensé en juin 1950 par le prix Strega pour son roman » Le Bel été » qu’il passe à l’acte dans une chambre de l’hôtel Roma, à Turin. Employé pendant de nombreuses années par la maison d’édition Einaudi il y sera le traducteur attitré de grands noms de la littérature mondiale.
Si son journal intime publié à titre posthume sous le titre « Le métier de vivre » constitue son œuvre majeure, pour l’essentiel, il aura été d’abord un poète. Pour lui, dira-t-il :
La poésie est une forme universelle et privilégiée. Existe : ce qui est poétique et ce qui ne l’est pas.
Cependant, en présentant le volume de la collection Quarto, de chez Gallimard, qui rassemble l’ensemble de ses œuvres, Dominique Fernandez, pour qui Pavese est le plus grand écrivain italien du XXe siècle écrira :
Tous ses poèmes, ses romans répondent à la même question : comment vivre dans un monde dont on se sent exclu ?
7 – Italo Calvino (1923 – 1985)
Comme ses compatriotes contemporains, Italo Calvino a été fortement marqué par les grands mouvements de l’après guerre post fasciste. L’ambiance familiale très engagée y a également été pour beaucoup. Ses débuts littéraires sont un peu lents et il se fait surtout connaître par ses articles pour différentes revues.
Il y développe une approche néo réaliste à la manière de Joseph Conrad sujet d’une thèse universitaire qu’il a écrit sur la littérature anglaise. Quand on lui en laisse la possibilité, il s’exprime volontiers sur un mode théâtral et dans un style qui emprunte beaucoup aux fables.
Pour France Culture, Italo Calvino, écrivain majeur du XXème siècle est un écrivain plein de fantaisie et de malice qui a cherché à repousser le plus loin possible les limites du roman traditionnel. D’où, entre autres, son compagnonnage avec ses compères de l’Oulipo.
Pour notre part, on en retiendra surtout la trilogie « Nos ancêtres » qui a fait sa célébrité. Celle-ci comprend trois titres, toujours aussi drolatiques : » Le vicomte pourfendu », « Le baron perché » et « Le chevalier inexistant » publiés à partir de 1952.
Bien installé comme cadre dans la maison d’édition Einaudi, un temps compagnon de route du PCI, comme beaucoup d’intellectuels de l’époque, lauréat du prix Bagutta 1959, pour se résumer, il aimait dire de lui, de manière un peu ironique et sans doute un peu aussi exagérée :
Je suis ligure; ma mère est sarde : j’ai le laconisme de beaucoup de ligures et le mutisme des sardes. Je suis le carrefour de deux races silencieuses.
8 – Grazia Deledda (1871 – 1936)

Sarde, Grazia Deledda l’est restée jusqu’au bout des ongles, même si une grande partie de son existence s’est déroulée à Rome. Autodidacte, originaire de Nuoro :
C’est l’âme de la Sardaigne, c’est la Sardaigne elle-même dans toutes ses manifestations ».
a-t-elle dit. Et son attachement pour une terre pétrie de traditions immémoriales sourd de toute son œuvre qui comprend 36 romans et 250 nouvelles. Elle accède à la célébrité avec la publication de son roman « Des roseaux dans le vent » en 1913.
Elle y développe l’idée que la vie humaine ressemble à bien des égards à celle des roseaux qui plient mais ne rompent pas. A plus forte raison quand ils sont bien ancrés dans leur terre ancestrale. Treize ans plus tard, elle sera la première lauréate du prix Nobel de littérature.
Sur 115 prix Nobel attribués depuis l’origine de ce prix, seuls 5 autres écrivains italiens en ont été récompensés :
- Giosue Carducci (1835-1907), prix Nobel 1906,
- Luigi Pirandello (1934 – 1936), prix Nobel 1934,
- Salvatore Quasimodo (1901-1968), prix Nobel 1959,
- Eugenio Montale (1896-1981), prix Nobel 1975,
- Dario Fo (1926-2016).
Trois sont des poètes ( Carducci, Quasimodo, Montale) et deux sont des dramaturges (Pirandello, Fo).
9 – Giorgio Bassani (1916 – 2000)
D’une grande famille de médecins juifs de Ferrare, bien intégrés dans la société locale, Giorgio Bassani n’en bifurquera pas moins vers d’autres horizons, notamment littéraires, dès qu’il sera en mesure de le faire.
Après une période de résistance contre le régime fasciste de 1937 à 1943, Giorgio Bassani œuvrera petit à petit dans le secteur de l’édition, puis de la télévision. Grand lecteur de Proust, ses thématiques préférées sont autant de manifestations de son goût pour les lieux de mémoire.
Outre les moments intimes qu’il y passe ou y a passé, à Ferrare, ville de la belle et intelligente Béatrice d’Este, la femme de Ludovic Sforza, dit le More, les brillants souvenirs de la Renaissance ne manquent pas.
Récompensé par le prix Strega en 1956 pour ses histoires de Ferrare, lauréat du prix Viareggio 1962 pour le jardin des Finzi-Contini, il reçoit également le prix Campiello en 1968 pour « L »airone ».
« Le jardin des Finzi-Contini » que l’on peut considérer comme son chef-d’œuvre est sans doute l’expression la plus pure de son talent littéraire, de sa grande culture et de son esthétisme. Il fera d’ailleurs l’objet d’un film par Vittorio de Sica :
10 – Giuseppe Tomasi Di Lampedusa (1896-1957)
Il n’est l’auteur que d’un seul roman et qu’aucun éditeur ne voulut publier de son vivant. C’est donc à titre posthume que « Le guépard » eut droit à une publication. Et cela grâce à l’intervention de Giorgio Bassani alors directeur éditorial de la maison Feltrinelli. Mais même là, il s’en est fallu de peu que rien ne se fasse. En effet, en conflit avec la maison d’édition, Giorgio Bassani finit par la quitter en 1963.
Aujourd’hui, le roman est devenu mythique. Quasiment dès sa parution, il est récompensé par le prix Strega. Et surtout, le film que Visconti a réalisé en 1963 à partir de son histoire avec des acteurs aussi fétiches que Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale a fini de le propulser sur les sommets de la littérature mondiale.
Mais, ce serait oublier un peu trop facilement la personnalité de son auteur, prince de Lampedusa, duc de Palma, baron de Montechiaro et de la Toretta, Grand d’Espagne de 1ère classe, en bref, grand seigneur de Sicile.
L’environnement familial comme source d’inspiration de la littérature italophone
Et ce qu’il décrit, c’est plus que la disparition d’un monde finissant et son remplacement par un autre, c’est aussi une méditation sur les fins dernières et la place que les honneurs peuvent jouer dans une vie. On connait la fameuse phrase du prince de Salina, « le guépard », son double romanesque :
Il faut que tout change pour que rien ne change.
Mais, comme l’a si bien remarqué le professeur d’université John Spangler dans un article très bien documenté consacré à la famille Tomasi, la tentation de se retirer d’un monde qui ne change pas et dont on a eu le temps et les moyens de faire le tour est une sorte de tradition familiale.
N’échappent apparemment à cette tentation que ceux qui se vouent à la défense de la culture et d’un certain art de vivre, comme lui-même, grand lecteur à l’instar de l’écrivain colombien Nicolas Gomez Davila. Ou son fils adoptif, Gioacchino Lanza Tomasi (1934 – 2023), important musicologue. Ou encore, quoique, à celle d’idées novatrices, comme Lanza del Vasto (1901-1981) nom de plume de Giuseppe Lanza di Trabia-Branciforte.
11 – Umberto Eco (1932 -2016)
On le connait pour son formidable roman « Le nom de la rose » qui lui vaut le prix Strega en 1981. Mais aussi grâce au film de 1986 du cinéaste Jean-Jacques Annaud avec Sean Connery. Il y campe un moine enquêtant sur une série de morts mystérieuses dans une abbaye bénédictine du nord de l’Italie en l’an de grâce 1327.
Le duo qu’il forme avec Christian Slater en moine novice est encore dans beaucoup de mémoires Le film obtint en 1987 le César du meilleur film étranger. Quant au roman, traduit en 43 langues, son succès ne se dément pas.
Derrière ce succès, il n’y a pas que le talent du romancier, il y a aussi celui du chercheur en sémiotique. Il ne s’est pas caché d’avoir fait de son roman une sorte de mise en pratique des résultats de ses recherches.
Et lui même apparait dans son rôle d’expert en sémiotique comme personnage de fiction dans deux romans. « La septième fonction du langage » de Laurent Binet et « Le club Dumas’ d’Arturo Perez-Reverte.
De son point de vue, fiction et faits peuvent s’entremêler heureusement pour donner la meilleure interprétation possible du réel. Pour peu qu’on sache voir ce qu’il y a à voir sans verser dans la pure fantasmagorie. Son deuxième roman « Le pendule de Foucault » paru en 1988 est encore plus explicite à cet égard.
Il y montre avec l’interprétation qu’il fait des mesures d’un kiosque à journaux toutes les dérives mentales et intellectuelles auxquelles cela peut conduire si on n’y prend garde. Avec son « Da Vinci Code », publié en 2003, Dan Brown a su exploiter toute la puissance romanesque que recèle le langage des signes et des symboles poussé à l’extrême.
12 – Ismail Kadaré (1936 – 2024)
L’auteur de « Le général de l’armée morte » qui l’a fait fait connaître en 1963 a pratiquement toujours vécu dans le pays où il est né : l’Albanie. Certes la langue officielle est l’albanais, mais l’italien y est presque une seconde langue maternelle. Reste d’une époque où l’Albanie fut une colonie italienne.
Longtemps, le pays, qui correspond à l’ancienne Illyrie du monde grec, fut un des moins accessibles au monde, un peu comme la Corée de Nord. Aujourd’hui, on se rue sur les plages de ce qu’on appelle la riviera albanaise. Incontestablement, cette ouverture, l’Albanie la doit en partie aux livres d’Ismail Kadaré.

Quand ce dernier écrit sur le totalitarisme, ce qui est le cas de pratiquement tous ses livres, il en parle en survivant. En survivant du pouvoir totalitaire d’Enver Hoxha, originaire comme lui de la ville historique de Gjiroskastër et mort comme lui à Tirana, sa capitale.
On lui reproche souvent de ne pas avoir su rompre suffisamment avec un régime détestable et d’avoir profité de sa position d’écrivain célèbre à l’étranger pour s’en accommoder.
Accommodement tout relatif puisque durant la « révolutionnarisation » des années 67 -68, révolution culturelle à la mode albanaise, il dut aller se faire « rééduquer » par le travail manuel à Bérat, la ville aux mille fenêtres.
Quoi qu’il en soit, toute l’œuvre d’Ismail Kadaré est une critique du totalitarisme sous toutes ses formes.
Tout tyran est une infinie potentialité de crimes.
a-t-il écrit dans « Froides fleurs d’avril », paru en 2000.
L’environnement socio politique comme source d’inspiration de la littérature italophone
Il y démontre avec maestria que l’on peut s’ opposer à tout environnement contraint, avec intelligence et efficacité, pour peu qu’on sache utiliser toutes les ressources de l’histoire et des traditions pour nourrir ses narrations.
C’est avec « Le palais des rêves« , publié en 1981, sans doute son chef d’œuvre, qu’il démonte avec le plus de minutie les délires et les mécanismes de tout pouvoir totalitaire, lequel, faut-il le rappeler, ne se résume pas à telle ou telle forme particulière. Ce qu’a parfaitement démontré un auteur comme Michel Onfray dans son ouvrage intitulé « Théorie de la dictature« .

Dans son roman, dystopique, Ismail Kadare raconte ainsi l’histoire de Mark Alem. Il a pour mission, naturellement au nom de la bonne cause, de recueillir les rêves de tout un chacun. Comme ses autres collègues, il les assemble en un tout intelligible. Le but est bien évidemment d’en profiter pour accroître l’emprise du pouvoir en place. Efficace, il finit par devenir le puissant administrateur en chef de l’organisation qui assure le traitement des rêves.
Après avoir lu le roman d’Ismail Kadare, on ne peut manquer d’y voir une sorte de prémonition. Difficile de ne pas y penser quand, par exemple, le Conseil de l’Union Européenne envisage, avec les meilleures intentions du monde, d’imposer aux services de messagerie comme Whatsapp de scanner automatiquement tous les messages privés dans le cadre de son projet de Chat Control.
Notons pour finir que pour Ismail Kadare la littérature ouvre indiscutablement un chemin vers la liberté quels que soient les censeurs qui voudraient la contraindre à n’exprimer que ce que le moment présent juge correct. De ce point de vue, Ismail Kadaré mérite amplement sa place au sommet de la littérature mondiale.
Autres auteurs remarquables de la littérature italophone
Bien évidemment, notre liste des grands auteurs italophones n’est pas complète. De fait, elle est bien loin de rendre compte de la richesse de la littérature italophone des cinquante dernières années. Beaucoup d’autres auteurs méritent d’y figurer.
Citons, notamment et dans le désordre :
- Erri de Luca ( 1950 -), prix Fémina étranger 2002 avec Montedidio,
- Claudio Magris ( 1939 -), prix Bagutta 1987 pour Danube, prix Strega 1997 pour Microcosmes,
- Elsa Ferrante (1943 – ), inscrite en 2016 par le magazine Time sur sa liste des 100 personnes les plus influentes dans le monde,
- et encore bien d’autres.
Toute immersion dans la littérature italienne renvoie inévitablement le lecteur d’un roman à un autre, du même auteur ou non. C’est ce renvoi qui fait aussi le charme de la lecture. Une phrase, une citation, une référence, au gré des pages, et c’est autant de clefs ouvrant des portes vers d’autres univers, d’autres réflexions essentielles.
C’est là sans doute un des meilleurs moyens qu’on puisse trouver, comme avec toute littérature de qualité, pour « booster » son inspiration et se lancer sans façon dans sa propre écriture, et pour finir dans une autoédition.