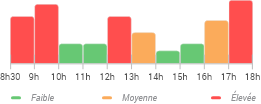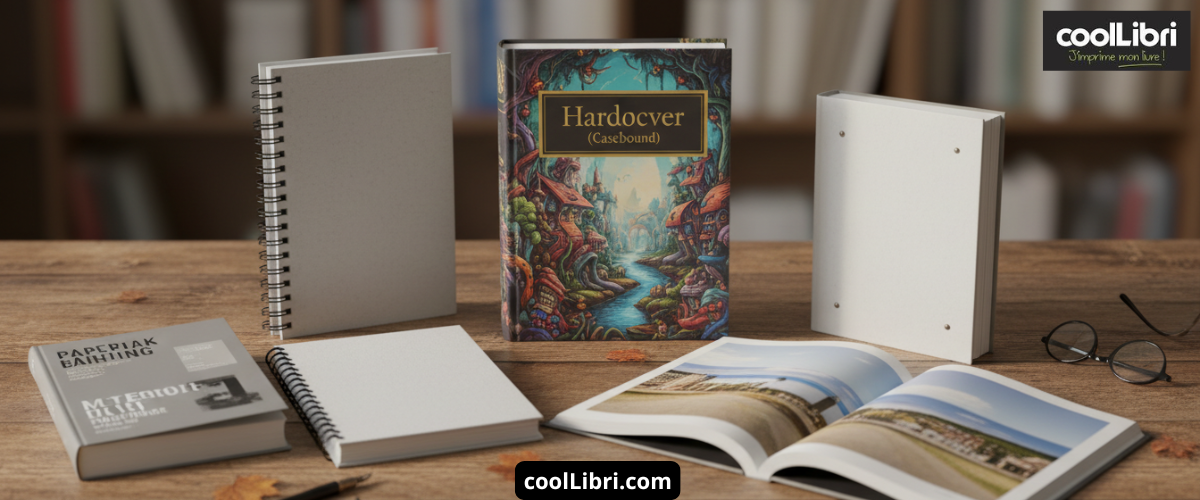On peut écrire comme on respire. Il suffit de prendre un crayon, de mettre une feuille blanche sur sa table de travail, puis de se lancer. On peut remplacer crayon par souris d’ordinateur et feuille blanche par écran digital. Le processus créatif est le même. En apparence seulement, car les moyens utilisés pour écrire influent inévitablement sur la manière d’écrire. C’est le premier sens que l’on peut donner à technique d’écriture et qui justifie qu’on en recherche la nature des effets sur l’écriture elle-même.
Il y a bien sûr un deuxième sens à l’expression technique d’écriture. C’est celui auquel on pense souvent en premier. Dans ce second sens, on peut assimiler la technique d’écriture au choix d’un procédé particulier, indépendant des outils utilisés, auquel l’auteur a pour principe de recourir systématiquement lorsqu’il écrit. C’est en quelque sorte sa signature ou sa marque. Au point que lorsqu’on voit la technique, on voit l’auteur sans même qu’il ait eu besoin de se signaler.
Or parmi toutes les techniques d’écriture possibles et imaginables, il en est tout un ensemble dont la maîtrise des fondamentaux de l’art du dessin constitue indiscutablement le dénominateur commun. En effet, pour les spécialistes, l’art du dessin est tout simplement à la base de toute création artistique.
Le dessin comme processus créatif à l’origine de toute œuvre d’art
Un livre est-il une œuvre d’art ?
On peut dire d’emblée que tout travail d’écriture visant l’appartenance à un genre littéraire particulier constitue un processus créatif en tant que tel. S’agissant de la conception d’une BD, de l’écriture d’un poème, la considération est évidente. Une BD est naturellement graphique et les sonorités d’un poème ne sont pas dues au hasard.
Mais, elle l’est aussi s’agissant des autres catégories définissant n’importe quel autre genre littéraire. Nul ne peut douter que les souvenirs romancés de Marcel Proust dans son œuvre maîtresse « A la recherche du temps perdu » constituent une indiscutable œuvre d’art.
En fait, on peut en dire autant des œuvres de tous les écrivains.
Bref, tout texte à prétention littéraire est forcement une œuvre artistique. Au même titre, entre autres, qu’une œuvre picturale, musicale ou architecturale. Or, si on l’examine avec attention, on se rend compte que l’art du dessin est à la racine de toute œuvre d’art, quelle qu’elle soit, et pas seulement picturale.
L’art du dessin à la base de toute œuvre picturale
C’est évidemment l’idée la plus simple à concevoir. On commence par faire un dessin, ou plus exactement, on fait des essais de fractions du tableau qu’on envisage de faire, puis, une fois qu’on se sent prêt, on passe aux choses sérieuses et on se lance dans la réalisation de l’œuvre que l’on espère magistrale.
Raison pour laquelle, à côté des tableaux des grands maîtres, fort connus, on trouve aussi une multitude de dessins préparatoires grâce auxquels le peintre a pu essayer différentes visions ou fragments de ce qu’il envisageait de faire.

Les principes de l’art du dessin à la base de toute œuvre
Or, tout bien considéré, on retrouve dans cette pratique du dessin préparatoire, l’origine même du mot dessin, autrement dit le mot dessein. Et cela dans la même acception que celle que l’on attribue à ce mot aujourd’hui. A savoir, celle de projet.
Ainsi, dans sa présentation de son ouvrage « L’art du dessin » sous titré Les processus de création, écrit par Eric Pagliano, édité par Citadelle et Mazenod, le distributeur Encyclopédia Universalis indique que :
L’ouvrage introduit avec finesse les diverses acceptions du mot « dessein ». Tout d’abord, le dessein désigne une pensée, une finalité, en l’occurrence l’intention qui guide l’artiste durant l’acte de création. Ensuite, le dessein -qui deviendra « dessin » – s’exprime de manière formelle à travers la ligne, les contours et la structure qui façonnent l’image. Il est aussi discipline avec ses outils et techniques, qui donnent vie aux idées …
Quand on se lance dans l’écriture, quel que soit le genre choisi, bien évidemment on poursuit un dessein. Et si l’écrivain ne dessine pas à proprement parlé, il est non moins évidemment que les mots qu’il utilise sont autant de lignes et de contours qui façonnent et structurent les images qu’il veut faire voir à ses lecteurs.
Quant à la discipline, aux outils et techniques qui donnent vie aux idées, si dans la forme ils sont différents de ceux que l’artiste-peintre peut mettre en œuvre, nul doute que sur le fond ils répondent aux mêmes exigences.
On ne peut bien écrire véritablement sans une certaine discipline ni la maîtrise d’un certain nombre d’outils et de techniques. Par suite, on ne peut manquer de constater un parallèle saisissant entre la gestation d’une œuvre picturale et celle d’une œuvre scripturale.
Comment utiliser les principes de l’art du dessin comme technique d’écriture
Les travaux préparatoires à l’écriture

Avant d’être dessin, l’œuvre d’art est donc un dessein. C’est le sens premier du mot dessin. Comme pour toute création, il y a donc forcément un dessein à l’origine de l’acte d’écrire. Le rappeler, c’est mettre l’accent sur tous les travaux préparatoires à l’écriture et leur nécessité. En bref, on n’écrit pas sans y avoir penser un brin. Autrement dit, sans s’y être préparé.
Ce qui, d’emblée, écarte toute idée selon laquelle il suffit de se mettre devant son écran d’ordinateur et de taper sur son clavier pour qu’instantanément les mots et les phrases d’une histoire jaillissent sur son écran.
Ces travaux préparatoires reposent notamment sur trois piliers fondamentaux : la recherche documentaire, la conception de plusieurs schémas narratifs et la rédaction de brouillons.
Recherche documentaire
Quand il écrit son chef d’œuvre « De sang froid « , Truman Capote passe plusieurs années à réunir les informations qui nourriront tout son roman. A tel point qu’il va être à l’origine d’un nouveau genre, le roman non fictionnel. De fait, ce sont ces informations, de tous ordres, qui vont peu à peu dessiner son schéma narratif.
Cette idée de construction, pas à pas, de l’histoire que l’on raconte est essentielle. C’est la raison pour laquelle il est très utile de recourir à la mise en œuvre d’un « chemin de fer ». Celui-ci prend la forme d’un découpage des différentes scènes que l’on prévoit pour l’intrigue de son roman en petits dessins, par exemple sur des posts it, que l’on relie entre eux autant que de besoin.
Schéma narratif illustré par un « chemin de fer »
Comme pour les dessins de l’artiste peintre, ces images permettent d’avoir une vue d’ensemble de la narration et d’en assurer la cohérence. Toutes choses égales par ailleurs, pas de bonne série policière sans voir ainsi apparaître à un moment ou à un autre un mur avec les photos des principaux protagonistes liés au crime sur lequel enquête l’équipe d’inspecteurs.
En l’occurrence, le travail des inspecteurs et celui d’un auteur déroulant une intrigue est très comparable. Mêmes hésitations, mêmes changements de perspective, mêmes fausses pistes. Ce sont là les principaux ingrédients de tout suspens.
Brouillons et ratures
La richesse de la documentation et les nombreuses idées d’intrigue peuvent avoir quelque chose de paralysant et conduire sans qu’on y prenne garde vers le syndrome de la page blanche. Ce moment difficile que connaissent tous les auteurs, à un moment ou à un autre, où ils sont saisis par le doute et se demandent si ce qu’ils ont entrepris de faire vaut vraiment la peine de continuer.
A cette éventualité, il n’y a qu’une réponse. Ecrire. A première vue, cette réponse est évidemment paradoxale. Comment, en effet, écrire alors même que toute envie d’écrire a complètement disparu. Du moins, semble-t-il. Car, de fait, à ce stade, on n’est pas devant un « vide », mais plutôt devant un « trop plein ».
En réalité, il est facile de ranimer l’envie d’écrire quand on se trouve dans dans cette situation. Il suffit d’écarter toute idée de vouloir à tout prix écrire d’emblée un texte parfait. Il suffit de se dire que ce que l’on écrit n’est jamais qu’un brouillon que l’on sera toujours à même de corriger, de raturer ou de remplacer. C’est bien là ce que fait l’artiste peintre avec ses dessins.
Ecriture automatique
Notons que si malgré tout rien ne vient, on peut toujours essayer de débloquer son écriture en recourant à l’écriture automatique. Un peu comme prendre une feuille de papier et tracer dessus des lignes au hasard. Sauf que curieusement, ces lignes ne sont pas si hasardeuses que ça et représentent toujours quelque chose.
C’est en s’en inspirant que les surréalistes ont imaginé qu’il pouvait en être de même pour l’écriture. En 1919, André Breton et Philippe Soupault ont écrit à ce sujet « Les champs magnétiques » pour en formaliser la méthode et en faire une technique d’écriture. Ce fut en tant que tel le point de départ du mouvement surréaliste.
Dans le cas qui nous préoccupe, la source d’inspiration n’est cependant pas l’inconscient, mais l’automatisme né d’une longue imprégnation, d’un lâcher prise et de la volonté de ne se donner aucune limite d’ordre moral ou esthétique.
Partant de là, comme dans le domaine pictural, des esquisses prennent forme, des bribes de scénarios s’accumulent et peu à peu deviennent des brouillons.
Les principes de l’art du dessin sont-ils une technique d’écriture applicable à tous les genres littéraires ?
Les principes créatifs de l’art du dessin sont naturellement applicables à tous les genres de la littérature. Mais, cette application peut être plus ou moins développée.
A minima, elle se manifeste, comme on vient de le voir, dans les travaux préparatoires, mais elle peut aller au-delà lorsque le dessin accompagne l’œuvre imprimée elle-même.
Dans ce cas, l’écrit devient lui-même œuvre graphique ou bien s’accompagne d’illustrations bien choisies qui viennent en appui du texte imprimé.
Exemples de technique d’écriture propre à la littérature graphique
Calligrammes

Le poète Guillaume Apollinaire s’est fait une spécialité des calligrammes. On peut lire, notamment, son célèbre poème « Le pont Mirabeau » sous cette forme. Qu’est-ce qu’un calligramme ? Pour le cnrtl, un calligramme, c’est :
Un texte écrit dont les lignes sont disposées en forme de dessins.
Bd, roman et essai graphique
Evidement, sans aller jusqu’à former une image graphique avec des lettres et des phrases, on peut renforcer le poids d’un texte en combinant texte et image comme on le fait dans les BD. Leur origine remonte au début du XIXè siècle et les premiers albums ne sont pas américains mais suisses. Le genre a longtemps été considéré comme infantile. Il n’en est évidemment plus de même aujourd’hui.
Le mode d’expression graphique mis au point dans les BD peut être désormais très sophistiqué, à la fois par les techniques employées – certaines planches sont de vraies œuvres d’art – et par la nature des textes dont certains peuvent être très philosophiques. A tel point que les romans ou les essais graphiques constituent un secteur de l’édition en plein essor.
On ne parle pas ici de la transmission simplifiée de savoirs sous forme imagée, mais de réalisations originales empruntant les techniques propres à la BD. La série « L’arabe du futur » qui raconte la vie de l’auteur, Riad Sattouf, en est un bon exemple.
Mouvement oulipo
Dans ce bref tour d’horizon de l’association entre le dessin et l’écriture, on n’aurait garde d’oublier les recherches menées par le mouvement Oulipo, autrement dit, l’Ouvroir de littérature potentielle. Le mouvement qui existe depuis une soixantaine d’années regroupe des spécialistes venus de tous horizons, pas forcément que des écrivains, dont le but est de stimuler la créativité en imposant des contraintes à l’écriture.
Comme dans l’art du dessin où la ligne sert de base à l’expression artistique et varie selon les règles imposées par les maîtres du moment, l’écriture oulipienne impose aux membres du mouvement une écriture respectant strictement une consigne, une structure ou une forme particulière.
A l’origine de ce mouvement, il faut naturellement citer l’écrivain Raymond Queneau. On peut dire qu’il est l’initiateur dans le domaine littéraire de ce qu’on peut appeler l’esthétique de la contrainte. C’est à un de ses membres, Hervé le Tellier, que le Goncourt 2020 a été attribué pour son roman « L’Anomalie ».
Reconnaissant pleinement sa dette à l’égard de la littérature sous contrainte, celui-ci n’a pas hésité à dire à cette occasion que :
Si je n’étais pas membre de l’Oulipo, j’aurais écrit un roman très différent.
De fait, la page finale du roman joue avec les lettres et laisse au lecteur le soin d’imaginer les phrases qu’elles composent.
Exemples de technique d’écriture propre à la littérature illustrée
Reste un autre domaine où littérature et dessin font bon ménage, c’est celui tout simplement où le dessin, et plus généralement l’illustration, accompagne intimement la création et le développement du texte.
L’homme en rouge, de Julian Barnes

« L’homme en rouge », de Julian Barnes (1946 -) est de ce point de vue bien intéressant. Né à Leicester, en Angleterre, de parents professeurs de français, diplômé d’Oxford, il commence sa carrière comme critique littéraire pour de grands quotidiens et magazines anglais. Auteur d’une trentaine d’ouvrages comprenant des romans, des essais, des chroniques et des mémoires, l’homme en rouge occupe une place à part dans cet ensemble.
Publié en 2019, il raconte l’histoire de Samuel Pozzi, une figure emblématique de la Belle Epoque. Médecin et chirurgien célèbre, Samuel Pozzi, membre de la haute société française de l’époque, familier de Sarah Bernard et de Robert de Montesquiou, a été le sujet d’un tableau en pied du grand portraitiste anglais John Sargent peint en 1881.
C’est en voyant cet étonnant portrait dans une exposition en 2015 que Julian Barnes s’est lancé dans l’écriture de ce qui n’est ni un roman, ni un essai, ni une biographie, mais plutôt la peinture du tableau d’un moment historique particulier, celui où l’Entente cordiale, signée à Londres en 1904, illustrait l’apogée de deux empires dont l’alliance aussi bien culturelle que politique dominait le monde entier.
Dans l’édition française de l’homme en rouge, réalisée par le Mercure de France en 2020, outre le portrait qu’en a fait John Sargent qui figure en bandeau, de nombreuses vignettes, dont beaucoup sont issues des collections Félix Potin des gens célèbres, parsèment le texte et contribuent à renforcer l’impression que veut donner l’auteur d’une époque bien différente de l’époque contemporaine, mais finalement pas si belle que ça.
Technique d’écriture du scrapbooking et des livres Assouline
Ajoutons, enfin, que les techniques de scrapbooking, si populaires aujourd’hui, sont une autre façon à coup sûr créative de rendre compte d’évènements personnels, et en particulier, de voyages.
On peut encore faire plus sophistiqué en réalisant avec ses propres photos et autres illustrations un de ces beaux livres Assouline dont on aura plaisir à laisser poser sur une table de salon afin que chacun puisse l’admirer.
L’art du dessin peut-il inspirer une technique d’écriture originale ?
En général, quand on parle de technique d’écriture, on pense stratégie d’écriture et choix d’un ou plusieurs procédés. Dans le premier cas, c’est avant tout une question d’organisation et d’objectifs à atteindre, dans le second, c’est avant tout une question de choix de point de vue, d’équilibre entre les parties et de rythme donné à la narration.
Penser dessin avant de penser stratégie ou méthode, c’est se mettre dans la peau de l’artiste peintre réfléchissant au tableau qu’il veut donner à voir et aux parties de ce tableau qu’il veut souligner. De ce fait, l’approche de l’auteur se fait naturellement symbolique et allégorique. Dans un tableau, quelle que soit l’école à laquelle il appartient, rien n’est jamais neutre.

Le livre de Timothy Brook intitulé « Le chapeau de Vermeer » en est une brillante illustration. Ainsi comme l’écrit un de ses lecteurs critiques :
Une simple jatte de fruit dans « la liseuse à la fenêtre » nous entraine sur les routes du commerce maritime de la fameuse porcelaine bleue et blanc en provenance de Chine, tandis qu’un somptueux chapeau de feutre dans « L’officier et la jeune fille riant « nous mène au Canada, jusqu’aux fourrures de castor que Samuel Champlain soutire à ses alliés hurons.
Autrement dit, l’art du dessin appliquée à la littérature oblige l’auteur à être attentif aux détails qu’il met en scène et à la signification qui peut leur être donnée. De ce point de vue, toute écriture devient ainsi un exercice murement réfléchi.