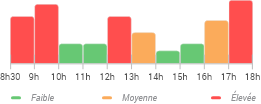Les récits de voyage constituent une part très importante de l’édition. Certains éditeurs se sont d’ailleurs spécialisés dans ce genre littéraire. Car c’est bien un genre à part entière. Et s’ils le font c’est qu’il y a des lecteurs en nombre suffisant.
Sinon à quoi bon s’y spécialiser. Donc les récits de voyage, ça marche ! D’où la question qui peut paraître oiseuse aux éternels voyageurs :
- Faut-il vraiment avoir voyagé pour écrire un récit de voyage ?
- Plus précisément, faut-il vraiment avoir été dans le pays dont on décrit les paysages et les mœurs ?
Autrement dit, à titre d’exemple, faut-il vraiment avoir été en Laponie pour raconter le voyage inoubliable qu’on a pu y faire ? Eh bien non ! Et tant pis pour les errants impénitents !
Tout cela n’est en fait qu’une question d’art. De technique littéraire. Au point que le récit d’un voyage qui a effectivement eu lieu écrit par celui qui l’a fait peut paraître moins vrai que le même écrit par un auteur qui s’est contenté de le vivre en étant confortablement installé dans son fauteuil habituel face à la fenêtre de son cabinet de travail.
Comment cela est-il donc possible ?
Tout travail d’écriture est un art
De fait, l’écriture en soi n’a rien de réel, ni d’objectif. Elle n’est qu’une transposition forcément limitée et, de surcroit, plus ou moins habile, d’un réel filtré par nos sens et notre culture. On imagine sans peine quelle réalité cela peut donner, au bout du bout.
Raison pour laquelle, les enquêteurs le savent bien, les témoignages, quand ils ne sont pas des mensonges délibérés, peuvent diverger totalement d’un témoin à l’autre pour une même scène vue au même moment.
Se libérer de la prétention des témoins à l’exclusivité de leur témoignage

Si on pose ce principe, c’est pour se libérer de la prétention du voyageur à l’exclusivité, bien compréhensible, de tout ce qui a trait à son voyage. Par conséquent, oui, on peut raconter un voyage sans l’avoir jamais fait.
Comme d’ailleurs, toutes les histoires qu’on peut raconter dans un livre. C’est cela même la magie de l’écriture. À condition, bien sûr, de préciser à l’intention de ses lecteurs qu’il s’agit d’un récit fictif et non pas d’un compte rendu exhaustif d’un voyage accompli de telle date à telle date.
On peut ainsi écrire, par exemple, une histoire policière, tout ce qu’il y a de plus vraie, mais en réalité seulement inspirée de faits réels et naturellement sans avoir fait l’expérience d’aucun crime ou délit. Il en est de même d’un voyage ou plus exactement d’un récit donnant la possibilité à ses lecteurs de découvrir un pays ou une région.
Il convient donc d’avoir bien présent à l’esprit que tout témoignage de toute façon est partiel et ne peut pas rendre compte d’une réalité dans sa totalité. Ajoutons que se contenter de ce seul témoignage non seulement est partiel, mais on ne peut plus partial, voire peut être totalement à côté de la plaque.
Dans ce dernier cas, les choses vues qui font l’objet d’un témoignage sont celles de témoins qui se contentent de ne retenir que ce qu’ils ont ressenti à un moment donné et entendu de ci de là.
Ne pas croire qu’une histoire non vécue est moins réelle qu’une histoire vécue
Une fois qu’on s’est libéré de la prétention des témoins à l’exclusivité de leur témoignage et de celle de tous ceux qui s’efforcent de faire leurs « choux gras » des « histoires vraies », il convient de se libérer de la croyance que n’est vrai que ce qui a été réellement vécu par l’auteur de l’histoire.
On en une bonne illustration avec Henri Beyle, autrement dit Stendhal, pour qui cette question était de la première importance et qui est sans doute le premier écrivain à avoir adopté un style d’écriture se voulant objectif.
L’exemple de romanciers célèbres ayant écrit sur un voyage
Cette illustration, elle est toute entière dans la manière dont il raconte comment Fabrice Del Dongo, personnage principal de « La Chartreuse de Parme », roman publié en 1839 qui lui valut la célébrité, traverse le champ de bataille de Waterloo sans se rendre compte de ce qui s’y joue, ni de l’importance des moyens mis en œuvre.
Certes, il s’agit d’un roman et par conséquent Stendhal n’a jamais prétendu qu’il s’était rendu sur le champ de bataille pour décrire ensuite ce qu’il y avait vu et entendu. Cependant, pourquoi sa description sonne-t-elle néanmoins si juste ?
L’incendie de Moscou raconté par Tolstoï dans son roman « Guerre et paix » est tout aussi réaliste que la scène de bataille racontée par Stendhal. Et pourtant il n’y était pas plus présent tant qu’écrivain que son collègue français.
A vrai dire, seul un écrivain en fauteuil est capable de faire un compte rendu plus réel, parce que plus complet et mieux documenté, que celui, forcément partial et partiel, que peut faire un témoin sur place. A moins qu’il ne fasse le même effort de documentation. Ce qui, avouons le, est de moins en moins fréquent.
Adapter la technique du roman fiction décrivant des faits réels et leur enchaînement à celle du récit
Le roman non fictionnel ou le roman réalité
Mais on peut aller plus loin que le roman simplement inspiré par des faits réels, on peut adopter la même technique littéraire que celle inaugurée par le grand écrivain américain Truman Capote (1924-1984) avec son roman « De sang froid » , « True crime« , en version originale.
Dans ce roman qui apporta la gloire à son auteur en plus des millions d’exemplaires vendus, Truman Capote met en scène une histoire véridique, celle d’un quadruple meurtre perpétré, sans mobile apparent, par deux malfrats, Perry Smith et Richard Hickock, à l’encontre d’une famille entière de fermiers.
Le meurtre a réellement eu lieu en 1959 à Holcomb dans le Kansas. Plus exactement dans la région qu’on nomme couramment la Bible Belt. Et dans le roman, les noms des assassins sont bien ceux des vrais assassins. De même que ceux tous les protagonistes de ce terrible drame.
Evidemment, Truman Capote n’a assisté en rien à celui-ci, mais il a enquêté auprès d’eux pendant près de 5 ans avant d’écrire son roman. Il finira même par se prendre d’amitié pour l’un des deux meurtriers, Perry Smith. Au point qu’après sa pendaison, ainsi que celle de son acolyte, il sombrera dans une profonde dépression.
Grâce à l’art du romancier, les faits bruts donnent lieu à l’élaboration d’un tableau qui les dépassent. Ce qui permet de brosser le portrait d’une Amérique profonde à un moment clé de son histoire.
Le récit de voyage non fictionnel
Sans avoir réellement voyagé dans telle ou telle contrée du monde, on peut s’inspirer du travail de Truman Capote pour faire comme si on l’avait parcouru de long en large. Le récit qu’on peut en tirer est bien réel en ce sens qu’il repose sur des éléments vérifiables par le lecteur, mais le narrateur le surplombe en n’ayant pas lui-même effectué le voyage dont il parle.
Il peut être paradoxal de parler de récit de voyage non fictionnel, le récit n’est-il pas à la différence du roman une narration naturellement non fictionnelle ? Sauf qu’un récit n’est pas une fiche de police ni un constat d’huissier mais une œuvre mêlant étroitement objectivité et subjectivité.
Par suite, parler de récit non fictionnel signifie simplement que la part imaginaire est réduite à sa plus simple expression. Les personnages y sont réels, les contextes aussi, hôtels, visites, activités, etc., de même que les circuits ou les trajets, seules les circonstances procèdent de l’imagination.
De fait, le narrateur n’a jamais fait le voyage dont il fait le récit. Ou seulement d’une manière très fragmentaire.
Comment se préparer à l’écriture d’un voyage qu’on n’a jamais fait

Mais pourquoi donc finalement se lancer dans l’écriture d’un voyage qu’on n’a jamais fait ? D’abord, parce que l’écriture est une manière de mettre en forme un rêve et que rêver de faire tel ou tel voyage est une de ces choses que la plupart des humains ont en commun. Alors pourquoi s’en priver !
Cependant, pour que ça marche, pour qu’on puisse y croire, il faut cesser de rêver et se mettre au travail.
Se documenter de manière exhaustive
La première étape pour écrire sur un voyage qu’on n’a jamais fait consiste à se documenter très sérieusement. Et heureusement, aujourd’hui, c’est très facile. Pour commencer, il faut rassembler la documentation dont on va avoir besoin.
Bref, il faut acheter des livres. Un tas de livres ! Et là encore, heureusement, on peut en acheter beaucoup d’occasion en se connectant sur l’un des nombreux sites, comme Momox ou Recyclivre, qui proposent des services inégalés dans ce domaine. On peut aussi se rendre chez le bouquiniste du coin.
Et puis vraiment, si on ne trouve pas son bonheur après avoir écumé sites web spécialisés et bouquinistes, on peut toujours aller voir son libraire préféré pour lui demander conseil et s’il le faut, on peut aussi y ajouter les documentalistes de la médiathèque locale.
Comment choisir sa documentation ?
La documentation dont on a besoin pour écrire un livre sur un voyage qu’on n’a jamais fait se trouve sur de multiples supports et dans de nombreuses catégories aux thématiques très diverses. Il faut donc faire un tri. Pour cela, il convient de procéder à la fois rationnellement et intuitivement.
Procéder rationnellement, c’est commencer par choisir un ouvrage quelconque ou un texte numérique parlant du lieu où l’on veut effectuer le voyage de ses rêves. L’essentiel, c’est qu’on ait envie de s’y plonger et de le lire d’une traite.
À partir de là tout va s’enchaîner naturellement. Si on prête suffisamment d’attention, ouvrage et texte sont bourrés de références et d’indications qui incitent à « creuser » dans telle ou telle direction. La recherche documentaire devient alors « panoramique » et on peut dire qu’elle se déroule de fil en aiguille.
Un exemple : écrire sur un voyage dans le Val de Loire

Prenons, par exemple, un voyage dans le Val de Loire dont on rêve depuis longtemps. On peut commencer par lire « Le roman de Chambord« , l’excellent ouvrage que Xavier Patier a écrit sur le plus grand et le plus intrigant des châteaux de la Loire.
On pense bien sûr automatiquement à François 1er qui en a été le promoteur au début de XVIème siècle et de là on passe à Louis XII, son prédécesseur, dont la résidence préférée était le château de Blois, puis à Henri II, son successeur, dont la favorite était Diane de Poitiers et la résidence préférée le Château de Chenonceau.
Ce faisant, on crée un lien entre trois lieux d’exception et une première sélection parmi les quelques 50 châteaux de la Loire qui méritent une visite. Et ainsi de suite. Comme chacun sait Léonard de Vinci serait à l’origine des plans du château de Chambord et de son étonnant escalier à double révolution du donjon central.
Voilà une excellente raison d’ajouter à son programme de visite, le château de Clos Lucé à Amboise qui a hébergé Léonard de Vinci pendant 3 ans, de 1516 à sa mort en 1519. L’année même où ont débuté les travaux du château de Chambord. Et évidemment, quitte à être à Amboise, autant visiter aussi son célèbre château.
On a là l’amorce d’un circuit touristique raisonné qui est d’ailleurs proposé par beaucoup d’agences de voyages, mais sans s’appesantir sur cette sorte de liens. Or ce sont ces liens, auxquels on peut en ajouter bien d’autres, qui vont notamment alimenter le récit du voyage rêvé. Et le rendre supérieur, par bien des aspects, à la simple narration d’un voyage réel.
Prendre des notes
Se documenter est une chose, en tirer parti en est une autre. Le corolaire indispensable à la recherche documentaire est le carnet de notes. On garde ce nom, même s’il peut prendre bien des formes à l’heure du tout numérique et du zéro papier.
Autrement dit, toute lecture avec une intention ultérieure d’écriture se fait « crayon à la main« . On peut faire ici une remarque sur le rôle joué par les carnets de notes ou les bloc notes auprès d’écrivains connus.
Un auteur comme Denis Grozdanovitch, par exemple, en a fait un élément essentiel de son style d’écriture. Ses carnets composés au fil de l’eau rythment ainsi les thématiques de ses différents ouvrages. Sans surprise et pour le plus grand plaisir des lecteurs, les citations et les références y abondent.
Dans son livre publié en 2025, intitulé « Une affaire de style« , il fait le tour des écrivains qui l’ont plus particulièrement marqué par leur désinvolture spéculative. Autrement dit, par une forme de scepticisme bien tempéré.
Les notes prises par de grands écrivains
Dans un long chapitre de ce livre intitulé « Mon long compagnonnage avec John Cowper Powys (1872-1963) , il livre à ses lecteurs tout ce que cet auteur lui a apporté pour l’aider à donner du sens à son existence.
On y trouve donc tout un ensemble de considérations et de citations qui sont l’exact reflet des notes que cet auteur lui a inspiré et qu’il a conservé dans ses multiples et précieux carnets.
Mais du fait de leur position dans le monde éditorial, certains auteurs parviennent à se passer de ces carnets. Tout simplement parce que leurs notes sont publiées au jour le jour dans un journal.
Ainsi du fameux bloc notes de François Mauriac (1885-1970) dans l’Express, puis le Figaro et des non moins fameuses chroniques d’Alexandre Vialatte (1901-1971) dans la Montagne, le quotidien de Clermond-Ferrand.
Evidemment, ces notes sont davantage travaillées que celles prises à la volée dans un carnet et destinées à y mûrir.
Comment raconter un voyage inoubliable en Laponie qu’on n’a jamais fait
Partant des quelques éléments développés dans les paragraphes précédents, si on devait raconter, par exemple, un voyage inoubliable en Laponie qu’on n’a jamais fait, comment pourrait-on s’y prendre.

Bien choisir la destination
Comme on va parler d’un voyage qu’on n’a jamais fait, on est donc libre de choisir la destination que l’on veut. Ce n’est pas rien. Pour bien faire ce choix, on peut s’inspirer justement de John Cowper Powys. En effet, avant d’être un auteur à succès, celui-ci a été un critique littéraire et un conférencier à succès.
Il savait notamment parler avec enthousiasme des auteurs qu’il avait choisis comme sujets de ses critiques et de ses conférences. Ses lecteurs et ses auditeurs ont adoré. Et pour les premiers, à l’instar de Denis Grozdanovitch, adorent toujours.
Dans le chapitre précédemment évoqué du livre de ce dernier, il en donne la raison :
Le plus extraordinaire avec lui [ Denis Grozdanovitch fait bien sûr référence ici à John Cowper Powys ] est cette méthode d’analyse littéraire qu’il nomme lui-même « l’analyse dithyrambique ».
Pour que les choses soient bien claires, Denis Grozdanovitch précise alors :
Lorsqu’on prend connaissance de l’étude que Powys a consacré à un auteur, on est persuadé que celui-ci représente un summum et qu’il est son écrivain de prédilection. Pourtant, à passer à l’étude suivante dans le recueil, on a la surprise de découvrir que le même enthousiasme et la même ferveur enflammée – ô combien communicatifs ! – sont à l’œuvre.
Remplaçons le mot « auteur » par celui de « destination » et on obtient à la fois la « bonne » destination et la méthode pour en parler.
Pourquoi choisir la Laponie ?

Si on applique la méthode Powys au choix de la Laponie, et d’une manière plus générale de la Finlande, comme destination du voyage qu’on n’a jamais fait, cela donne un ensemble de raisons pour lesquelles il est facile de s’enthousiasmer.
La première de ces raisons est qu’année après année le World Happiness Report, c’est-à-dire le rapport mondial sur le bonheur fruit d’un partenariat entre Gallup, l’Oxford Wellbeing Research Centre et le réseau des solutions de développement durable des Nations Unies classe la Finlande et donc la Laponie qui en constitue une large part comme le pays le plus heureux au monde.
Voilà une excellente raison pour s’y rendre sans qu’il soit a priori besoin d’en chercher d’autres. Oui, mais qu’y a- t-il vraiment derrière un tel classement ? Les aurores boréales, l’immensité des forêts primaires, la présence du peuple indigène le plus ancien d’Europe seraient-ils les facteurs essentiels de ce bonheur ?
En tout cas, chercher à savoir pourquoi, c’est être d’emblée conquis par la perspective de se rendre au-delà du cercle polaire.
Un pays tête d’affiche dans de nombreux domaines
Evidemment, ce n’est pas tout. La Finlande est un petit pays avec à peine 5 millions d’habitants. Alors comment se fait-il qu’un si petit pays, bien peu riche, dominé à tour de rôle pendant des siècles par ses voisins russes, norvégiens, suédois, ait pu devenir en à peine quelques décennies une locomotive dans le secteur high tech ?
Tout le monde connait Nokia dont le siège social est situé à Espoo à quelques encablures de la capitale finlandaise Helsinki.
Entre autres. Car l’excellence des artistes finlandais n’est également plus à démontrer. Nombre d’entre eux se sont illustrés au niveau mondial. Citons, notamment, des designers comme Alvar Aalto, des écrivains comme Arto Paasilinna, Mika Waltari, Vaïno Linna ou Tove Jansson. Ou encore, le célèbre compositeur de symphonies, Jean Sibelius (1865-1957).
Et ce n’est pas tout. Des têtes d’affiche dans le domaine des beaux-arts, on peut facilement glisser dans celui de l’art de vivre et essayer de comprendre les arcanes de l’esprit sisu et de l’usage généralisé du sauna.
Bref, une fois qu’on a choisi d’écrire le récit d’un voyage que l’on veut inoubliable en Laponie, reste à organiser sa recherche documentaire en fonction des thématiques dans lesquelles le pays s’est particulièrement illustré et à composer un récit qui donne envie à ses lecteurs de s’y rendre séance tenante.
Comment écrire sur voyage qui donne envie d’aller en Laponie
On ne peut pas écrire sur tout ce qu’il peut y avoir d’intéressant à voir et à faire en Laponie. Cependant, une chose est sûre. Il faut faire un tri, s’efforcer de sortir des sentiers battus et montré combien on aime ce qu’on a pu trouver en « faisant ce voyage ».
Faire un tri
Cela suppose d’avoir quelques critères de sélection. Deux attitudes sont possibles. La première consiste à ne considérer que ses propres coups de foudre et tant pis s’ils ne conviennent pas à tout le monde. L’autre se veut plus objective. On essaie de se mettre à la place d’un peu tout le monde.
Dans ce cas, on s’efforce d’être le plus exhaustif possible et de répondre aux attentes du plus grand nombre de profils. Bref, on fait un guide touristique comme il en existe beaucoup.
Sortir des sentiers battus
Si on veut néanmoins sortir des sentiers battus, on peut donner à son écriture un tour beaucoup plus personnel. Cette fois un peu à la manière de ces rédacteurs de blog toujours par monts et par vaux.
Cela dit, de ce point de vue, on peut faire mieux. Plutôt que d’en rester au stade des expériences et du vécu, on peut y ajouter des aperçus sur l’environnement au sens large dans lequel on a choisi de se plonger, en l’occurrence, par exemple, la Laponie.
Par environnement, il faut entendre non seulement l’environnement naturel, mais aussi l’environnement culturel. On a évoqué plus haut l’esprit sisu qui explique bien des aspects du mode de vie des finlandais et de leurs réactions.
Aimer ce qu’on voit et aimer en parler
Mais on peut encore aller plus loin et montrer combien ce mode de vie et ces réactions ne sont pas le fruit du hasard, et encore moins le résultat de l’usage intensif du sauna, mais de l’existence d’une tradition immémoriale que traduit bien un auteur comme Vaïno Linna dont l’incipit de son œuvre majeure, « ici, sous l’étoile polaire » est aussi connu que celui de Proust.
Son roman qui retrace l’existence d’une famille de paysans de Tampere, deuxième ville de Finlande, au centre du pays, du début du siècle jusqu’à la seconde guerre mondiale, commence ainsi :
Au commencement étaient le marais, la houe – et Youssi.
En moins de 10 mots tout est dit de l’âme finlandaise : l’état brut du pays, la rudesse du travail pour le mettre en état et l’opiniâtreté des natifs. Ici, les paysans, plus haut, au-delà du cercle polaire, les Samis, éleveurs de rennes.
Et si on veut encore aller plus loin, on peut s’interroger sur les effets de la confrontation entre cet univers traditionnel et celui de l’Europe occidentale contemporaine. Le roman « O » du jeune écrivain et rocker alternatif Miki Liukkonen, né à Oulu, en Ostrobotnie du Nord, en 1989, et mort à Helsinki en 2023, à 33 ans, peut en donner une idée.
En tout cas, l’incipit de ce roman foisonnant peut donner à réfléchir :
L’instant où l’être humain se résout à mourir n’est pas nécessairement celui où il sait qu’il meurt.
A quoi ça sert d’écrire sur un voyage qu’on n’a jamais fait ?
On a dit plus haut que le récit de voyage correspondait à une attente des éditeurs. Alors pourquoi pas ajouter la catégorie récit de voyage non fictionnel mais non effectué à leur catalogue ? N’y a-t-il pas là une source inépuisable d’inspiration ? De quoi écarter à tout jamais le syndrome de la page blanche ?
On vient d’en lister un certain nombre d’avantages. On peut pratiquement tous les classer sous un même chapitre. Celui de la plus grande richesse des informations que ces récits peuvent rassembler.
Le résultat, c’est que pour finir, ça donne envie d’aller voir sur place si tout ce qui est raconté s’y trouve bien. Autrement dit, plus, peut-être, que les récits de voyage qui rendent compte d’un périple ou d’une expérience, les récits d’un voyage qu’on n’a jamais fait sont, pratiquement à coup sûr, une invitation au voyage.
Bien mieux, sans aucun doute, que les brochures des voyagistes. En tout cas, pour reprendre les mots du navigateur Loick Peyron :
Le plus beau voyage, c’est celui qu’on n’a pas encore fait.
Sachez qu’une fois votre aventure mis sur papier, vous pouvez imprimer votre récit de voyage sur CoolLibri, toujours au meilleur tarif