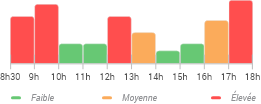Les tableaux de maître sont une incroyable source d’inspiration. Le nombre de tableaux ayant inspiré de grands ou de moins grands auteurs est impressionnant. Ce constat n’a en fait rien de mystérieux. Le lien entre l’art du dessin et l’art de l’écriture repose sur le même processus créatif.
On peut donc partir de l’un pour arriver à l’autre et inversement. Si cette inversion n’est pas a priori évidente, c’est qu’on oublie tout simplement que derrière tout tableau, il y a un dessin.
Certes ce dessin est plus ou moins explicite, mais il est on ne peut plus réel, ne serait-ce que parce qu’il est naturellement la manifestation d’un dessein. Avec un « e » ! Et c’est précisément pour cette raison qu’un tableau est autant inspirant. Qu’est-ce qui se cache, par exemple, derrière le sourire de Mona Lisa sur fond de paysage inconnu ?
Qu’a voulu dire, ou plus exactement signifier, Léonard de Vinci en peignant La Joconde ? Pour Javier Sierra qui a écrit « La cène secrète » à partir de l’immense fresque réalisée par Léonard de Vinci sur un mur du monastère de Santa Maria della Grazie de Milan, la réponse ne fait aucun doute. En tout cas, il en a fait tout un roman, et même un polar, qui entraîne ses lecteurs dans les méandres des hérésies et de l’inquisition au XVème siècle.
Or Javier Sierra est loin d’être un cas unique. Un tableau est donc une source naturelle d’inspiration, mais comme on peut facilement l’imaginer, les formes qu’elle peut prendre sont extrêmement diverses.
Ainsi à examiner une liste bien fournie de romans inspirés par un ou plusieurs tableaux, les textes auxquels ils peuvent donner lieu sont, en général, de trois ordres. Ce peut être des biographies individuelles ou collectives, des romans policiers ou encore des essais.
Les romans policiers ou d’investigation inspirés par un tableau réel ou fictif
Dans le genre, on pense naturellement à ces deux excellents ouvrages que sont « Le tableau du maître flamand » d’Arturo Perez Reverte et à « L’affaire Arnolfini » de Jean Philippe Postel. Les deux peuvent servir d’exemple, chacun dans leur registre, à l’écriture d’un roman, en l’occurrence de nature policière, inspiré par un tableau.

« Le tableau du maître flamand », d’Arturo Perez Reverte (1951 – )
Dans le cas, de celui d’Arturo Perez Reverte, ce qui est remarquable, c’est que le tableau qui sert de cadre à l’intrigue est un tableau complètement fictif. Tout y est inventé par l’auteur. Les personnages, la composition et le peintre ! Enfin presque, et c’est là que cela devient intéressant, parce que l’artiste peintre imaginé par l’auteur est très proche à la fois par les couleurs et par le nom patronymique d’un artiste peintre ayant réellement existé !
Arturo Perez Reverte invente donc l’artiste peintre Pieter Van Huys en s’inspirant de Pieter Huys (1519-1584). Pour le reste, l’auteur n’hésite pas à tordre le cou, avec un grand savoir faire, il faut bien l’avouer, à ce que l’on sait de l’esthétique de l’art flamand à cette époque. Pieter Huys a, en effet, plutôt peint des scènes dans le goût de Jérôme Bosch plutôt que de représenter avec art une partie d’échecs comme celle, très réelle, de son même fictif.
S’informer précisément sur l’esthétique du peintre dont on s’inspire
Notons, d’ores et déjà, que l’inspiration née d’un tableau suppose que l’auteur du roman ait une bonne connaissance du peintre qui lui sert de source d’inspiration. Ajoutons de plus, ce qui ne gâte rien, que dans le cas d’Arturo Perez Reverte, cette connaissance se double de celle du jeu d’échecs dont on suit une partie à la fois dans le passé et le présent.
Cette combinaison doublement inspirée a assuré le succès de l’auteur et lancé véritablement sa carrière de romancier après plus de vingt ans de carrière comme correspondant de guerre pour plusieurs journaux.

L’affaire Arnolfini », de Jean Philippe Postel (1951 – )
Plutôt que de roman policier, il est préférable de parler ici de roman d’investigation. L’auteur n’est ni historien d’art, ni spécialiste du roman noir, né en 1951, Jean Philippe Postel a exercé la médecine jusqu’en 2014. Et c’est donc en clinicien, pour ne pas dire en médecin légiste, qu’il s’est attaqué au mystère du célèbre tableau de Jan Van Eyck, « Les époux Arnolfini ».
Car il y a un mystère « Arnolfini ». Certes, on peut se contenter d’aborder le tableau en amateur d’art et plus spécifiquement en amateur de l’école flamande de la Renaissance. Dans son ouvrage, Jean Philippe Postel recense d’ailleurs dans sept pages de références les nombreuses études qui ont été consacrées au fil du temps à l’œuvre du peintre génial qu’est Jan van Eyck. D’ailleurs, on peut le considéré sans peine comme un des grands maîtres de l’art occidental.
Mais, s’arrêter à cette seule considération, ce serait oublier combien les détails comptent à une époque où l’écriture et la lecture étaient encore le fait d’une petite élite. Celle là même qui est à l’origine de la dénomination « république des lettres« . La lecture d’une œuvre d’art par le détail, c’est à cela qu’invite, à juste titre, un auteur, pour le coup solide historien de l’art, comme Daniel Arasse, dont un des ouvrages s’intitule précisément « Le détail« .
Retrouver l’art de la lectio divina grâce aux détails
Le fait est qu’à l’époque de la conception du tableau de Van Eyck, en 1434, la lectio divina allait naturellement de soi pour toute lecture et écriture savante. Autrement dit, il allait de soi qu’on ne pouvait comprendre une œuvre, quelle qu’elle soit, qu’en prenant la peine d’en respecter les différents niveaux de lecture comme il était de mise pour la lecture de la Bible. Ce en quoi celle-ci peut d’ailleurs toujours être considérée comme un bon exemple de composition.
Outre ce rappel des conditions d’écriture propres à une époque – ce qui est aussi une bonne façon de rappeler qu’il est difficile, voire carrément absurde de juger d’une époque à partir d’un regard uniquement contemporain – il n’est pas inutile de se souvenir que Jan Van Eyck, dont « L’homme au turban rouge » est peut-être l’autoportrait, a également été une sorte d’agent secret, grassement rémunéré, pour son commanditaire, le puissant duc de Bourgogne, alors Philippe le Bon. Ce dernier étant alors quasi l’égal du roi de France et pouvant légitimement imaginer pouvoir jouer un rôle central en Europe.
Ces quelques considérations essentielles suffisent à montrer que comme le disent si bien les spécialistes comme Daniel Arasse que :
Pour comprendre, il suffit de regarder.
Et nul doute qu’un rapide passage devant le tableau exposé à la National Gallery de Londres, s’il peut réellement susciter une vague d’émotions n’est, en aucune façon, « regarder » et donc être suffisant pour pénétrer les arcanes de ce que l’on regarde et être capable d’en retirer la substantifique moelle comme le préconisait François Rabelais dans le prologue de son deuxième roman Gargantua.
Les romans biographiques individuelles ou collectives
Beaucoup de personnages historiques ont laissé peu de traces en dehors de leur représentation picturale. Pour essayer de les faire revivre, on n’a alors guère le choix que de laisser courir son imagination et d’en faire un roman.
Plus encore, certaines représentations picturales de personnages célèbres en leur temps laissent leurs spectateurs sur leur faim. Curieusement, plus le temps passe et moins on sait de qui il s’agit. Ce qui ouvre de larges portes à l’imagination des romanciers.
On en a un bel exemple avec un tableau du Titien, le maître de l’art du portrait. Celui qu’il a peint entre 1540 et 1545 connu sous le nom de « l’anglais » ou de « portrait d’un gentilhomme » et actuellement exposé dans la galerie palatine du palais Pitti à Florence est ainsi plein de mystères.

L’homme aux yeux gris, de Petru Dumitriu (1924 – 2002)
Le tableau du Titien enflamme facilement les imaginations car selon les historiens d’art, ce serait le portrait de Henry Howard, comte de Surrey. Ou peut être bien celui d’Ottavio Farnèse, duc de Parme et de Plaisance. A moins qu’il ne s’agisse plutôt de celui du juriste Ippoliti Riminaldi.
Pour l’écrivain Petru Dumitriu, c’est plus simple. Le portrait est celui de « l’homme aux yeux gris », titre du premier volume d’une des meilleurs trilogies de la littérature mondiale. Qui est-il donc ?
Cet homme ne parle pas. Son mutisme n’est qu’une façade. Il parle avec ses yeux. Gris comme une lame, ils vous transpercent; un regard froid qui de sa vivacité porte un coup à l’âme, désormais perdue dans les méandres du tableau.
Pour Petru Dumitriu qui a connu les honneurs puis les avanies du régime communiste roumain, au point de fuir à l’ouest au début des années 60, l’homme aux yeux gris, c’est Archange.
Un seul regard peut suffire à être une source d’inspiration infinie
Son périple commence à Tolède qu’il fuit avec sa bien-aimée pour échapper au bûcher, où son judaïsme le condamne, pour essayer de trouver le lieu en Europe et au-delà où il pourra vivre paisiblement de son industrie et de ses multiples dons.
Sans finalement y parvenir, malgré d’incontestables succès, sauf à considérer que son retour à Dieu, ou à quelque chose qui y ressemble, est une porte de sortie plus qu’ honorable.
En réalité, à bien des égards, le roman est une sorte de transposition des tribulations vécues par l’auteur une fois passé à l’Ouest et de la précarité qu’il lui a fallu endurer une fois installé là-bas, malgré ses talents d’écrivain.
Ses succès sous le régime communiste devenant un handicap pour les critiques occidentaux. Rien de bon ne pouvant en être issu. En bref, le tableau du Titien a été pour Petru Dumitriu le catalyseur narratif qui lui a permis d’échapper à un présent souvent déprimant et d’en sublimer les épisodes en autant de leçons de vie.

L’homme en rouge, de Julian Barnes (1946 – )
Un tableau n’est pas qu’une source d’inspiration pour évoquer un destin individuel. Il peut l’être aussi pour tout un environnement social. Ainsi de « L’homme en rouge », tableau peint par le peintre américain John Singer Sargent (1856 – 1925) en 1881 qui représente chez lui, Samuel Pozzi, célèbre médecin et chirurgien, inventeur de la gynécologie moderne.
Ce tableau remarquable qui fait de John Singer Sargent un maître du portrait à l’égal du Titien l’est d’autant plus que ses portraits étaient jusque là essentiellement féminins et que comme l’a brillamment démontré Julian Barnes avec son roman éponyme, il est aussi l’expression intime de toute une époque, celle qui est restée dans l’histoire comme étant la Belle Epoque.
Ayant parfaitement intégré le fait que cette dernière a correspondu à un sommet de la civilisation européenne, Julian Barnes, un des 10 meilleurs auteurs anglophones contemporains, en a fait un roman éponyme et le vecteur privilégié pour en mettre en scène les ombres et les lumières. Dans ce roman, il ne se contente pas en effet de raconter l’histoire de Samuel Pozzi. En réalité, il élargit son récit à l’ensemble de ses fréquentations.
Faire revivre tout un monde
A côté de Samuel Pozzi dont il reconstitue l’histoire de manière évidemment romancée, on voit ainsi prendre vie toute une galerie de personnages réels comme Robert de Montesquiou, Henry James, Sarah Bernard, et bien d’autres. Le procédé n’est pas nouveau, mais reste toujours aussi séduisant. Notons, au passage, que ces mêmes personnages se retrouvent, sous d’autres noms, dans cette vaste fresque littéraire qu’est « A la recherche du temps perdu« , de Marcel Proust.
Sans avoir un tableau comme point de départ, mais un manuscrit pour Stephen Greenblatt, avec « Quatrotrocento« , un bateau, le « Pourquoi pas ? », navire océanographique du commandant Charcot, pour Kate Cambor, avec « Belle Epoque« , tout simplement, ces auteurs parviennent à faire revivre tout un monde pour le plus grand plaisir de leurs lecteurs. En général, très nombreux !

Le portrait, de Pierre Assouline (1953 -)
Journaliste, chroniqueur pour la presse écrite et la radio, animateur du blog « La république des livres« , rédacteur pour les magazines Lire et l’histoire, membre de l‘académie Goncourt depuis 2012, la liste est longue des titres, des fonctions et des prix qui émaillent toute une existence consacrée aux lettres et à l’histoire.
Auteur de nombreux romans – son dernier, une autofiction, intitulé « L’annonce« , est paru en 2025 et raconte la permanence d’un lien amoureux malgré le temps passé et la distance géographique – Pierre Assouline est aussi connu pour ses biographies. Certaines comme celles qu’il a consacrées à Georges Simenon, Marcel Dassault, Gaston Gallimard ou encore Hergé ont fait date.
Faire la biographie d’une famille
Avec « Le portrait », paru en 2007, Pierre Assouline met en pratique l’idée que l’on peut toujours partir d’une fiction pour raconter l’histoire d’une famille. Le portrait, c’est celui, bien réel, de la baronne Betty de Rothschild, peint par Ingres, en 1848. De grande dimension, il fait 141 x 101 cm, il fait encore partie des collections de la famille de Rothschild. La fiction, c’est ce qu’on peut en dire.
Car, c’est là que le romancier intervient, le portrait n’est pas toujours resté dans les mêmes mains. Il a même été confisqué un moment par les nazis ! En suivant ses pérégrinations, de lieu en lieu, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, Pierre Assouline restitue ainsi pour ses lecteurs non seulement l’histoire d’une famille, mais aussi celle d’une certaine société.
Les essais philosophiques construits autour des œuvres d’art

Les voix du silence, d’André Malraux (1901 – 1976)
Il est bon de rappeler que l’œuvre d’art qui nous parait aller tellement de soi aujourd’hui n’a pas toujours eu cette place centrale et essentielle qu’elle occupe désormais avec tant d’autorité.
Au point d’en éliminer tout ce qui pouvait la rattacher précisément à l’identité du sujet représenté pour n’être plus qu’un objet de curiosité magnifié par un musée. Dés lors c’est la fonction primordiale du musée qui interroge en premier. Avant même l’œuvre d’art.
Du moins si l’on en croit André Malraux. Dans le chapitre intitulé « Le musée imaginaire » qui ouvre « Les voix du silence« , celui-ci écrit en effet :
Le rôle des musées dans notre relation avec les œuvres d’art est si grand, que nous avons peine à penser qu’il n’en existe pas, qu’il n’en exista jamais, là où la civilisation de l’Europe moderne est ou fut inconnue; et qu’il en existe chez nous depuis moins de deux siècles.
Le XIXème siècle a vécu d’eux; nous en vivons encore, et oublions qu’ils ont imposé au spectateur une relation toute nouvelle avec l’œuvre d’art. Ils ont contribué à délivrer de leur fonction les œuvres d’art qu’ils réunissaient; à métamorphoser en tableaux jusqu’aux portraits.
Et c’est là que se révèlent les musées imaginaires d’auteurs qui sans musées et leurs catalogues illustrés n’auraient pas eu accès à l’immense capital culturel qu’ils ont amassé au fil du temps, ni à toutes les histoires laissées en friche du fait de leur principale mission dévolue à la conservation des œuvres d’art qui leur ont été confiées.
Le musée, pur produit de la modernité, devient dès lors une source tellement inépuisable d’inspiration qu’un seul tableau ne suffit pas à calmer la soif de création des auteurs qui s’y laissent prendre. Le roman, le récit, devient alors celui d’un musée imaginaire. Deux auteurs s’y sont particulièrement distingués : Paul Veyne et Michel Butor.

Mon musée imaginaire, de Paul Veyne (1930 – 2022)
Paul Veyne est un historien dont la renommée dépasse le cadre hexagonal. Professeur au Collège de France, spécialiste du monde antique, il a laissé des œuvres qui ont fait date et dont les thèses sont aujourd’hui incontournables. On lui doit notamment « Quand notre monde est devenu chrétien » ou encore « Palmyre, l’irremplaçable trésor ».
Outre son approche particulière de l’antiquité, ce qui a fait son succès, c’est aussi d’avoir considéré l’histoire comme un roman vrai. De ce point de vue, on comprend qu’elle puisse être une source infinie d’inspiration. Or quoi de mieux qu’un tableau pour en ressusciter les moments les plus tragiques ou les plus significatifs.
Centré sur la peinture italienne, le musée imaginaire de Paul Veyne se veut une promenade dans ses chefs d’œuvre et notamment ceux qu’éclairent les lumières de l’histoire sainte et de l’antiquité romaine.
Un choix inédit de pièces maîtresses
Paru en 2010, réédité en 2022, l’ouvrage de Paul Veyne fait partie de ces beaux livres qui ont naturellement leur place dans toute bibliothèque. Il y commente 255 tableaux en 33 chapitres qui sont pour lui autant de salles de son musée. Encadrées par un prologue et un épilogue, elles retracent et resituent ce grand moment de l’art occidental qui va de l’art gothique au XIIIème siècle à l’art rococo du XVIIIème siècle.
Les salles II et III sont ainsi consacrées pour l’essentiel au précurseur qu’a été Giotto, puis, entre autres, les salles XIII, XIV, XV, et XVI à ces monuments de la peinture italienne que sont Botticelli, Léonard de Vinci, Michel Ange et Raphael, et pour finir, les salles XXI, XXVII, XXXII, à ces quasi modernes qu’ont été Le Titien, Le Caravage et Tiepolo.
Le tout enrichi, comme il se doit pour un historien, par une solide Bibliographie qu’il intitule modestement « Repères bibliographiques ». Tout auteur désireux de se lancer dans l’écriture d’un roman ou d’un récit inspiré par un tableau a ainsi à sa disposition un choix incomparable d’œuvres maîtresses assorties d’un décryptage qui peut être bien utile pour élaborer un schéma narratif de qualité.
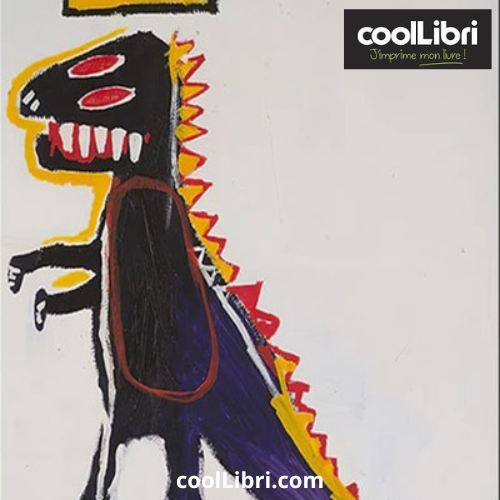
Le musée imaginaire, de Michel Butor ( 1926 – 2016)
On peut comprendre que les chefs d’œuvres sélectionnés par Paul Veyne, si spectaculaires soient-ils, peuvent apparaître comme étant par trop circonscrits dans le temps et dans l’espace aux yeux d’un grand nombre de contemporains.
Initiateur du mouvement dit du « Nouveau Roman » avec d’autres auteurs comme Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet ou Claude Simon, Michel Butor, dont la carrière littéraire a été lancée par son roman « La modification« , paru en 1957 et récompensé la même année par le prix Renaudot, a une vision beaucoup plus large de ce qui, pour lui, fait référence dans l’esthétique picturale.
Dans son livre majeur, « Le musée imaginaire de Michel Butor » paru en 2015 aux éditions Flammarion, il s’attarde sur 105 œuvres de peintres occidentaux, en commençant par Giotto et en terminant par Jean-Michel Basquiat.
Comme pour Paul Veyne, chacune des œuvres retenues pour son musée imaginaire fait l’objet d’un décryptage. Evidemment, compte tenu de son choix éditorial, ses commentaires définissent et illustrent un parcours vers la modernité.
D’où leur répartition très synthétique en 6 chapitres intitulés « Des murs aux pages », « Le regard du nord », « Vertiges de la bourgeoisie », « La révolution qui n’en finit pas », « La technique au défi » et « Interrogations sans frontière », faisant de l’artiste peintre un irremplaçable témoins de son temps et par là même une source incomparable d’inspiration.
Comment écrire un roman à partir d’une œuvre d’art
Une œuvre d’art raconte toujours une histoire. Comme le montre si bien Arturo Perez-Reverte dans son roman « Le tableau du maître flamand », cette histoire se situe à plusieurs niveaux. Dans le roman précité, il en détermine précisément six avant d’indiquer qu’ils peuvent être finalement innombrables comme les combinaisons d’une partie d’échecs.
C’est pour cette raison que l’attention portée à un tableau, en commençant par ce qu’il y a de plus simple à faire, regarder, conduit inévitablement à imaginer des scènes, des histoires, des personnages, des intrigues qui sont les ingrédients de tout roman.
Cela dit, comme dans le cas des auteurs figurant dans notre liste, on peut s’en tenir au cadre formel dessiné par l’artiste peintre servant de référence, mais on peut aussi, l’oublier complètement et ne garder que la trame qu’il a su inspirer pour construire un récit totalement nouveau.