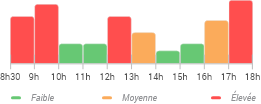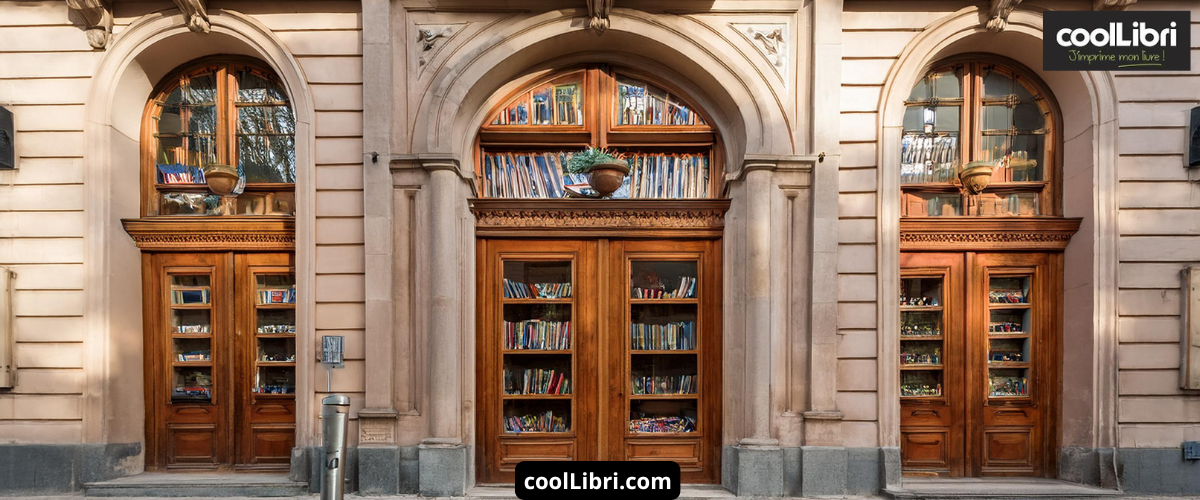Les autofictions ont le vent en poupe. Normal, elles permettent de passer allègrement par dessus le syndrome de la page blanche. Ce syndrome, tous le auteurs le connaissent à un moment ou à un autre. On veut écrire, on noircit des pages d’écrans avec des idées en tout genre, mais décidément rien ne vient. Tout s’embrouille et d’un roman, on passe à deux, à dix, et puis on efface tout et tout penaud on va voir dehors si l’inspiration va enfin se manifester. Or, avec une autofiction, on résout quasiment l’énigme de la quadrature du cercle. Les idées y sont toutes trouvées. Sans peine.
Ce sont celles qui tissent jour après jour sa propre vie. Elles naissent, entre autres, des regrets qu’on peut avoir, des angoisses qui nous réveillent chaque nuit ou des espoirs qui nous font rêver. Oui, mais est-ce vraiment intéressant ? En quoi est ce que ces micro évènements, pour la plupart, mais que l’on croit essentiels, vont-ils, peut-être, émouvoir des centaines de lecteurs, et même, on l’espère, des milliers. C’est là qu’intervient la magie de l’autofiction.
C’est quoi une autofiction ?
L’autofiction ressemble comme deux gouttes d’eau à une autobiographie, mais ça n’en est absolument pas une. Tout ce qu’on y raconte met bien en scène l’auteur de l’autofiction et son entourage, mais les évènements qu’il y relate sont on ne peut plus arrangés.

Ils sont vrais sans être vrais. L’idée qui en est à la base c’est ce jeu que connaissent bien les enfants quand ils jouent à » On dirait que je suis Zorro et toi le sergent Garcia. Ah, non pas d’accord ! C’est moi Zorro et c’est toi le sergent Garcia ! »
Différence entre autofiction et autobiographie
Autrement dit, dans une autofiction, on se sert de faits réels que l’on connait bien puisqu’ils correspondent à des évènements que l’on a vécu, mais on les enserre dans un schéma narratif, naturellement fictionnel, pour les mettre en valeur et en faire quelque chose que n’importe quel lecteur peut s’approprier.
A l’inverse, une autobiographie ne cherche pas à rendre intéressant le narrateur, elle dit simplement ce qui est et ce qui s’est passé. Elle cherche à expliquer un cheminement en respectant un certain ordre dans l’exposé des évènements.
Du moins pour l’essentiel, car enfin, il est bien difficile d’écrire une autographie si on n’éprouve pas un minimum de sympathie pour celui ou celle qui en est l’objet. Mais, c’est là une autre affaire.
La série des « Claudine » écrite par Colette sous le nom de son mari « Willy » constitue un bon exemple de ce que peut être une autofiction et de l’impact qu’elle peut avoir sur ses lecteurs. On peut même dire qu’elle en a créé le genre.
Colette, créatrice du genre

Les premières lignes de l’incipit du premier livre de la série, « Claudine à l’école », paru en 1902, sont les suivantes :
Je m’appelle Claudine, j’habite Montigny, j’y suis née en 1884; probablement je n’y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s’exprime ainsi: « Montigny en Fresnois, jolie petite ville de 1950 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thaize ; on y admire une tour sarrasine bien conservée.. » Moi ça ne me dit rien du tout, ces descriptions là !
Démarrent alors les aventures d’une jeune fille en fleur, aurait dit à la même époque Marcel Proust, qui n’ont pas laissé indifférente toute une génération de femmes et de jeunes filles désireuses d’échapper à un univers par trop dominé par les valeurs masculines.
Quel point de vue narratif adopter dans une autofiction ?
La nature du point de vue narratif, c’est un peu la tarte à la crème de tout atelier d’écriture qui se respecte. A juste titre, d’ailleurs. Car, avant de se lancer dans l’écriture de tout récit fictionnel, roman ou autofiction, il convient de bien savoir quelle attitude l’auteur se doit d’adopter pour exprimer ce qu’il a envie de dire.
Le point de vue omniscient dans l’autofiction
Doit-il se réfugier dans une espèce de nirvana ou d’étoile comme Sirius, d’où il voit tout, le présent, le passé et le futur, le sien et celui de tout le monde, on parle alors de point de vue omniscient, à l’égal de celui d’un dieu ? Impossible est-on tenté de dire.
Sauf que l’auteur sait tout de ce qui est arrivé à son personnage central et de ce qu’il pense. Forcément, puisqu’il s’agit de lui-même. Quant à ce qui lui manque, il peut l’inventer, autant qu’il le veut, puisqu’il s’agit de toute manière d’une fiction.
De préférence à tout autre pronom, il utilise alors le « il ». Cela dit, le « il » n’est pas le pronom préféré de l’autofiction. Si on le laisse faire, il peut finir par donner un tour très impersonnel à la narration. C’est pourquoi on lui préfère, en général, le « je ». Dans ce cas, on parle de point de vue interne ou de point de vue externe.
Le point de vue interne dans l’autofiction.
On peut laisser de côté le point de vue externe, celui qui correspond à l’objectif d’une caméra. Pour la même raison que celle qui pousse à écarter le « il », c’est-à-dire, son côté impersonnel. Même si, comme pour le « il », le narrateur sait tout de ce qui l’entoure et voit tout.
Avec le « je » du point de vue interne, le narrateur, héros principal de son récit, retranscrit tous les évènements dont il est plus ou moins le jouet à travers le filtre de sa sensibilité et de sa compréhension du monde.
On a évoqué plus haut, Colette, vraie reine en son temps de la république des lettres, et sa série des Claudine, on peut tout aussi bien évoquer dans le même registre, Marcel Proust et son maître ouvrage « A la recherche du temps perdu ». Ainsi de sa relation avec Gilberte, tout à la fois réelle et irréelle. Dans le passage ci-après, il y décrit ce qu’il pense que la jeune fille pense de lui.
Après avoir posé le principe suivant, naturellement omniscient, procédé qui fait d’ailleurs toute la force de « La recherche » :
Le temps dont nous disposons chaque jour est élastique ; les passions que nous ressentons le dilatent, celles que nous inspirons le rétrécissent, et l’habitude le remplit.
Ce qui donne le résultat suivant qu’il suppose être la pensée de son amie à son égard :
D’ailleurs, j’aurais eu beau parler à Gilberte, elle ne m’aurait pas entendu. Nous nous imaginons toujours quand nous parlons, que ce sont nos oreilles, notre esprit qui écoutent. Mes paroles ne seraient parvenues à Gilberte que déviées, comme si elles avaient eu à traverser le rideau d’une cataracte avant d’arriver à mon amie, méconnaissables, rendant un son ridicule, n’ayant plus aucune espèce de sens.
Moyennant quoi, il ne fait rien, ne dit rien, laissant au temps le soin de régler les choses, si tant est qu’elles doivent l’être. Comme l’auteur est omniscient, il sait, par avance, que c’est ce qui va se passer et que par conséquent il a eu bien raison d’agir ainsi.
Au demeurant, on voit là toute la force de l’autofiction et du point de vue omniscient qu’on peut y adopter, car elle donne largement la possibilité à l’auteur d’explorer en long et en large tous les méandres de sa destinée et de l’arranger à sa manière.
Peut-on mixer les points de vue narratifs ?
Dans « A la recherche du temps perdu », le point de vue omniscient se mêle au point de vue interne quand le narrateur formule un point de vue général sur l’existence ou imagine ce que tel autre personnage de sa narration peut penser.
Avec le roman « L’Amant » de Marguerite Duras, paru en 1986 et lauréat du prix Goncourt la même année, on a un autre bel exemple de mixage de points de vue. Cette fois, entre un point de vue interne et un point de vue externe.

Au tout début de son roman après une série de réflexions sur le temps qui passe et ses effets sur les corps, la narratrice se mue ainsi en caméra et transporte ses lecteurs loin en arrière pour les plonger dans l’environnement et les sensations de ses débuts :
J’ai quinze ans et demi. C’est le passage d’un bac sur le Mékong. L’image dure pendant toute la traversée du fleuve. J’ai quinze ans et demi, il n’y a pas de saisons dans ce pays là, nous sommes dans une saison unique, chaude, monotone, nous sommes dans la longue zone chaude de la terre, pas de printemps, pas de renouveau.
Le mixage des points de vue est en fait nécessaire, même si dans une autofiction, le point de vue interne est largement prédominant. Il permet, en effet, de bien faire respirer le texte et d’en faire varier le rythme.
Comment entremêler évènements réels et évènement fictifs ?
On vient de voir que si le point de vue habituel d’une autofiction est le point de vue interne et n’interdit pas d’y mêler aussi selon le style et le schéma narratif qu’on adopte, les deux autres points de vue, le point de vue omniscient et le point de vue externe, question mixage, il en est de même de la nature des évènements rapportés dans l’autofiction.
Nature des évènements réels rapportés dans une autofiction
Comme on l’a dit plus haut, une autofiction n’est pas une autobiographie, mais elle s’en rapproche beaucoup. Autrement dit, les évènements qui vont constituer le corps et la trame de l’autofiction vont être liés à la vie réelle de l’auteur.
Ce sont ses pensées, son environnement, ses rencontres, leur évolution, qui vont nourrir pour l’essentiel son schéma narratif. Pour ce qui est des premières, elles proviennent de ses souvenirs, d’un éventuel journal intime, de témoignages ou des propos que des proches ont pu ou peuvent tenir.
Souvenirs, regrets et remords dans l’autofiction
Evidemment, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver tant les sentiments, les regrets, les remords, peuvent venir les biaiser. A l’inverse, il est beaucoup plus facile de recréer à peu près objectivement les éléments constitutifs d’un environnement. Environnement géographique, bien sûr, mais aussi, bien que ce soit plus délicat, environnement familial et amical.
Cet environnement, ce sont d’abord des lieux. Ce sont aussi des généalogies. Les uns et les autres ne sont pas à négliger. Si on s’arrête un instant au grand auteur classique qu’est Balzac, on ne peut que noter l’usage quelque fois abusif qu’il a pu faire dans les romans composant sa comédie humaine de la topographie et de la toponymie.
Topographie et toponymie dans l’autofiction
Il en a ainsi fait d’importants supports à sa démonstration des facteurs régissant les liens sociaux. Autrement dit : « Dis moi où tu habites, et je te dirai qui tu es. » Le fait est que dès que l’on entre dans un univers romanesque, et une autofiction constitue bien un univers romanesque, tout a un sens. Le nom, le prénom, les lieux de vie, les habitudes sociales, les études suivies, etc.
Une critique littéraire, Nathalie Solomon, a ainsi bâti tout un chapitre de son livre paru aux éditions Presses Universitaires de Rennes, intitulé « Topographies romanesques », sur :
Le rôle structurant de l’espace chez Balzac : le topos qui cache la forêt.
Elle y fait une très subtile analyse du rapport entre les lieux, les personnalités de ses personnages et leur évolution en fonction des lieux qu’ils découvrent ou qu’ils abandonnent.
Rôle des expériences dans l’autofiction
Autre champ d’importance pour une autofiction, celui des expériences. C’est peut-être même le plus important, celui qui peut-être a suscité l’envie d’écrire, de se justifier, de trouver des raisons à des échecs, de mieux comprendre pourquoi on est là où l’on est.
Ces expériences sont de plusieurs ordres. Ce peut être des expériences sentimentales comme ce peut être des expériences sociales. Dans le roman « Stupeurs et tremblements », paru en 1999 et qui a lancé véritablement sa carrière, Amélie Nothomb y raconte l’histoire d’Amélie-san, la sienne donc, aux prises avec les lourdeurs et les subtilités du travail dans une entreprise japonaise.
Son incipit en est la clef de sol dont toute la narration va dériver :
Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de monsieur Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi je n’étais la supérieure de personne.
Après une telle entrée en matière, on s’attend au pire, et pire, il y a effectivement puisque la pauvre Amélie-san se retrouve finalement placardisée et chargée de nettoyer les toilettes, simplement pour avoir outrepassé son rôle par souci d’efficacité.
Au passage, le roman d’Amélie Nothomb est une excellente analyse de l’impact que peuvent avoir des relations interculturelles mal maîtrisées. Et cela, en dépit des bonnes intentions qu’on peut avoir et de la bonne connaissance du milieu culturel dans lequel on évolue.
Les évènements fictifs dans l’autofiction
Comme dans tout roman, il y a une morale dans une autofiction. Plus exactement, l’autofiction est l’occasion pour son auteur de tirer les leçons de ce qu’il a vécu. Mais, pour que la leçon porte et dépasse les seules limites de la sphère personnelle, il est nécessaire d’introduire dans l’histoire des évènements qu’on n’a pas réellement vécu, mais qui auraient pu réellement l’être.
C’est à ce stade que la fiction rejoint la réalité ou que la réalité aurait très bien pu être fictive. Sur quoi donc la fiction peut-elle venir entrelarder le réel ? Sans qu’on ne puisse, bien sûr, voir l’artifice.
Rencontres avec des personnages de fiction
Au cours d’une existence, on rencontre beaucoup de gens. Certains qu’on oublie très vite même si la relation semble avoir duré longtemps. D’autres qu’on n’oublie pas, bien qu’on les ait rencontrés très brièvement. Avec ceux-ci on aurait aimé prolonger plus avant la relation.
Mais les circonstances, le hasard, s’y sont opposés. L’autofiction permet de combler ce manque. Elle permet de donner une consistance à des échanges pourtant fortuits. Cette consistance résulte de la connaissance extérieure qu’on peut avoir de ces personnes, par leur œuvre par exemple, ou de la force des sentiments qu’ils ont pu inspirer.
En tout cas, ils méritent à juste titre qu’on leur réserve une belle place dans le récit. Ce ne sont pas vraiment des personnages de fiction, puisqu’ils existent ou ont existé bel et bien, mais ce qu’on en dit, même si la manière dont on le dit a tous les accents de la sincérité et de la vérité n’en est pas moins fictif.
On peut évidement aller plus loin et inventer carrément des rencontres avec des personnes qu’on n’a jamais rencontrées. Mais, dans ce cas, l’autofiction prend un tour romanesque qui peut nuire à son authenticité.
Séjours fictifs dans des lieux inspirants
Autre élément qui peut donner une coloration particulière à un moment du développement de l’autofiction, le séjour dans un lieu particulièrement inspirant. Ainsi de certains hôtels. On n’a fait qu’y passer, mais le bref séjour qu’on y a fait, qu’il s’agisse d’une nuit ou d’un moment passé au bar de l’établissement et c’est tout un tas d’émotions qui surgissent avec l’évocation des personnalités qui l’ont fréquenté et les idées qu’ils ont pu susciter.
On a bien sûr en tête le Grand Hôtel de Cabourg puisqu’on a parlé plus haut de Marcel Proust. C’est celui là même qui a servi de décors à son Grand Hôtel de Balbec. Il y a séjourné, chaque été, de 1907, date de son ouverture, à 1914. Dans la même chambre, la chambre 414, dont malgré les modernisations successives, le mobilier est resté le même que celui qu’il a connu.
Bien d’autres établissements de qualité ont une atmosphère qui rappelle leurs grandes heures. Citons par exemple, l’hôtel de l’Univers à Tours qui a reçu à une époque tout ce que le monde occidental comptait de grands hommes. Une quarantaine d’entre eux ont d’ailleurs été peints sur la galerie du hall d’entrée par François Pagé, un artiste peintre local aux multiples talents.
Notons, enfin, qu’il existe, entre autres, une très active société des hôtels littéraires. Sur son site dédié, elle précise ainsi ses intentions :
Chaque hôtel littéraire est unique. Nous voulons faire partager notre passion pour un écrivain au sein d’une ville dans laquelle il a vécu. La décoration de l’hôtel rend hommage à l’auteur choisi par de multiples approches artistiques et contemporaines.
Pour finir, écrire une autofiction est-il à la portée de tout le monde ?
En principe, oui, puisqu’une autofiction est une forme romancée d’une autobiographie. Et comme forcément tout le monde peut écrire une autobiographie, forcément tout le monde peut écrire une autofiction.
Evidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Il faut avoir des choses intéressantes à dire. Mais c’est quoi ces choses intéressantes ? Elles sont de deux sortes. Ce sont soit des expériences inédites, de voyages, de rencontres, etc., soit des pensées lumineuses, au minimum marquantes et originales.
On peut naturellement passer outre. C’est la raison pour laquelle une autofiction est vraiment à la portée de tout le monde. Après tout, peu importe que ce qu’on raconte n’intéresse que soi-même ou un cercle restreint de lecteurs. Qu’est-ce que ça peut faire ?
Comme tout auteur le sait très bien le lectorat n’est pas égalitaire et n’est pas lié au nombre de pages écrites. La plupart du temps, il va où on le pousse à aller ou encore, là où il a l’habitude d’aller.
Par conséquent, se lancer dans l’écriture d’une autofiction, c’est d’abord se pencher sur soi-même, qui que l’on soit, sans se préoccuper de savoir si on est intéressant ou pas, mais en espérant tout de même l’être un peu.
Pour une simple et bonne raison, ce que l’on pense, ce que l’on vit, d’autres le pensent aussi, le vivent aussi. Cependant, s’ils n’écrivent rien, ce n’est pas parce qu’ils n’en ont pas envie, c’est qu’ils n’ont tout simplement pas une volonté ou une détermination suffisante pour le faire.
Et c’est de toute façon leur rendre service que de leur tendre son propre miroir et de leur permettre ainsi de s’y voir et d’en tirer des leçons qu’ils ne pourraient avoir sinon, du moins, pas aussi clairement.