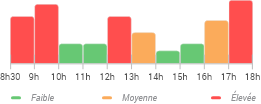La volonté pour écrire est là, bien là. Des idées, on en a, beaucoup, peut-être même trop. Mais, comment les mettre en forme ? Autrement dit, quel genre littéraire leur est-il le plus adapté ? Roman, essai, BD ? Comment choisir ? Faut-il obligatoirement suivre les recommandations des spécialistes dans ce domaine ? Car enfin, ces idées qui nous sont chères, pourquoi, par exemple, les exprimer sous forme de roman, si on en n’aime pas le procédé.
Que faire si on préfère les essais aux romans, si on trouve que les rares tentatives qu’on a pu faire pour amorcer un roman ont toutes paru laborieuses et artificielles ? C’est à ces questions et à bien d’autres qui se révèleront au fur et à mesure qu’est consacré cet article. Après l’avoir lu, les apprentis auteurs devraient être plus sûrs de ce qui leur convient comme genre littéraire en fonction de leur projet éditorial et suivant leur style habituel d’écriture.
Un genre littéraire, qu’est-ce que c’est ?
Suivant qu’on aime l’exhaustivité ou les généralités, on peut en faire une liste détaillée comprenant un nombre impressionnant d’items ou se contenter d’une définition générale et de quelques exemples. Par ailleurs, les ouvrages ou les cours ne manquent pas sur la question qui est un peu « la tarte à la crème » de toute étude littéraire.

Définition générale du genre littéraire
Pour se mettre en train, commençons par une définition générale assortie de quelques catégories. Le genre littéraire nous dit Wikipédia, et là on peut lui faire confiance, est :
Un système de classement des productions littéraires selon leur forme, leur contenu, ou leur registre.
D’autres préfèrent dire que :
Le genre littéraire désigne des catégories de textes aux caractéristiques similaires : une même présentation, une même structure.
Quoi qu’il en soit, sur ce plan général, on distingue cinq grands genres littéraires, le roman, le théâtre, la poésie, l’essai et la nouvelle. On peut aussi les ramener à trois si on ne considère que leur aspect fictionnel ou pas.
De ce point de vue, on distingue alors la fiction, la non fiction et les autres genres, c’est-à-dire ceux qui n’appartiennent ni à l’un ni à l’autre, comme la poésie. L’intérêt de cette classification qui peut paraître bien sommaire, c’est qu’elle met l’accent sur un aspect qui a une incidence fondamentale sur la nature de ce qui inspire une œuvre écrite. Ou pas, d’ailleurs.
Nul doute que l’origine de l’inspiration, imagination ou faits réels, est un élément déterminant dans le choix d’un genre particulier.
Petite liste exhaustive de genres littéraires
Le fait d’avoir deux définitions générale différentes du genre littéraire – il y en a bien d’autres possibles – pousse certains spécialistes à aller au fond des choses et à essayer d’établir une liste comprenant tous les genres susceptibles de figurer dans une catégorie. Et pour éviter que cette liste ne soit par trop rébarbative et en faciliter la lecture, ils la divisent la plupart du temps en genres et sous genres.
Si on en revient au site Wikipédia, la poésie, grande catégorie générique consacrée, l’Art poétique rassemble sous son intitulé pas moins de 37 sous genres ! Si on comprend assez facilement l’intitulé de nombre d’entre eux comme la ballade, la chanson, la fable ou encore l’élégie ou le haiku, entre autres, on reste un peu plus indécis, voire carrément perplexe, du moins en première analyse, devant des intitulés comme l’oaristys, le serventois, la villanelle ou le ghazel.
Exemple de sous-genre de l’Art poétique : l’oaristys
Pour les curieux, mais c’est en fait très sérieux, l’oaristys, c’est tout simplement un type de poème qui met en scène une idylle ou un entretien tendre, nous dit le dictionnaire, entre deux personnes. Paul Verlaine l’emploie dans un de ses poèmes – un poème renvoyant donc à un autre poème ! – quand il écrit :
Ah ! Les oaristys ! Les premières maîtresses ! L’or des cheveux !
Ce qui dans un autre registre donne chez André Gide la phrase suivante extraite de « Si le grain » :
Notre vie commune commençait de si bien s’arranger (…) Quand, par la suite, je racontais notre oaristys à Albert, je fus naïvement surpris de le voir, lui que je croyais d’esprit très libre, s’indigner d’un partage qui nous paraissait, à Paul et à moi, naturel.
En mêlant la nature de l’écrit à la technique utilisée pour écrire, on peut ajouter au genre poétique 9 autres genres, dont certains se démultiplient en sous genres et même en sous sous genres. On peut ainsi différencier 25 sous genres de romans auxquels on peut adjoindre 30 sous sous genres. De quoi normalement trouver chaussure à son pied si on veut se lancer dans l’écriture d’un roman.
Si en bon comptable, on en fait le compte, on arrive à un total de près de 120 genres, sous-genres et sous-sous-genres. Et sur la première marche du podium, on trouve l’art poétique, puis le roman et en troisième, ce qu’on appelle les formes brèves, sans doute par défaut d’imagination.
Exemple de sous-sous-genres de Roman : Light Fantasy, High Fantasy et Dark Fantasy
Le sous genre, c’est bien sûr le roman fantasy, à ne pas confondre avec le roman fantastique. Dans ce dernier, l’univers est réel, tel qu’on le connait et cela quel que soit l’époque et l’environnement. Seulement, voilà, ce qui le rend fantastique, c’est que dans ce monde réel, il y a du surnaturel. La Bible peut être vue sous cet angle.
Dans un roman fantasy, tout est autre. Les animaux parlent ou volent, des créatures se mêlent aux humains, les règles qui régissent leurs mondes n’ont rien à voir avec celles que nous connaissons. C’est dans cette catégorie qu’on peut classer des romans très connus tels que, par exemple, « Le seigneur des anneaux » de J.R.R Tolkien ou « The Witcher » d’Andrzej Sapkowski.

Les connaisseurs définissent volontiers près d’une quinzaine de types de romans de fantasy. Pour ne pas alourdir la présentation, on ne s’intéressera ici qu’à trois.
Romans de Light Fantasy
Cela dit, le roman fantasy peut adopter différents styles, ou tons, si on préfère. Si la tonalité est moqueuse, ou d’une manière générale, humoristique, on dit alors qu’il s’agit d’un roman qui traite des choses avec légèreté, d’où la sous sous catégorie « Light Fantasy ». On trouve là des romans comme « Les annales du Disque Monde » de Terry Pratchett, « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll, ou encore « Le magicien d ‘oz » de Lyman Frank Baum. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas sérieux. Le livre de Lewis Carroll en est un bel exemple.
Romans de High Fantasy
Ce sont des romans ambitieux où s’affrontent le Bien et le Mal. Les personnages y sont très sérieux et le héros principal a la lourde mission de sauver le monde. Ce faisant, il évolue et de personnage sympathique, mais sans envergure, devient progressivement un héros au fil des épreuves qu’il traverse et surmonte. En général, il évolue dans un univers baroque extrêmement détaillé. On cite souvent dans cette catégorie « Le trône de fer » de George R.R Martin ou encore « Le secret de Ji » de Pierre Grimbert.
Romans de Dark Fantasy
On y retrouve là aussi la lutte entre le Bien et le Mal, mais ce dernier est apparemment le grand vainqueur. On n’est pas loin d’y verser dans l’horreur à chaque page ou, en tout cas, d’y vivre ou survivre dans un monde apocalyptique. « La tour sombre » de Stephen King ou « Orcs » de Stan Nicholls en constituent de bonnes illustrations.
Exemple d’un sous genre du genre Forme brève : listes et apophtegmes
Pas besoin, après tout, d’écrire des milliers de pages pour intéresser des lecteurs. On peut se contenter d’écrire une liste de phrases ou de mots bien sentis, seule, articulée avec d’autres ou insérée dans un récit plus traditionnel.
L’écrivain colombien Nicolas Gomez Dasilva (1913-1994) par exemple, aborde toutes sortes de sujets, d’ordre philosophiques, littéraires ou politiques, entre autres, traduit en français par Michel Bibard, sous forme de scolies ou d’apophtegmes. Apparemment, ils n’ont aucun lien entre eux, mais « vus de loin », ils composent un ensemble très structurés où chaque mot compte.
D’autres auteurs comme Pascal Guignard ou Charles Dantzig préfèrent faire des listes. Dans « Chambord-des-Songes« , par exemple, Charles Dantzig a un entier chapitre composé de listes. Intitulé « compréhension du passé », il dresse ainsi la liste de ce qu’ils n’avaient pas en 1526 et celle de ce qu’ils n’avaient pas. La juxtaposition des deux listes, ce qui en fait la force, est tout simplement saisissante.
Particularités propres à chaque genre littéraire
Pour renouveler l’approche des genres littéraires, considérons qu’ils sont comme des tribus et voyons où ça nous mène. Et notamment si cela peut nous aider à bien choisir son genre littéraire. Au demeurant, l’originalité de cette approche est plus banale qu’on ne pense car elle s’inspire des nombreuses recherches ayant pour objet les styles de vie.

C’est quoi un style de vie ?
De ce point de vue, chacun donc a ses us et coutumes. Chacun se regroupe en « nations ». Et même s’il y a des transfuges, une fois qu’on a trouvé sa tribu d’appartenance et qu’on s’y est fait reconnaître, il est toujours difficile d’appartenir un jour à l’une et un autre jour à une autre
Tout simplement parce que les « terrains de chasse » n’ont plus rien à voir les uns avec les autres. De plus, un bon essayiste ne fait pas forcément un bon romancier. Et vice versa. Autrement dit, un bon chasseur de lapins ne fait pas forcément un bon chasseur de sangliers. Prenons quelques exemples pour y voir plus clair et surtout pour en faire une mécanique opérationnelle.
En tout cas, et c’est ce qui a fait le succès de la notion de style de vie, on dit aussi socio-style, celle-ci est beaucoup plus parlante que celle, plus simple, sans doute, de CSP. Autrement dit, de classification suivant les revenus et la catégorie socio-professionnelle d’appartenance.
Le fil conducteur pour définir un style de vie est celui posé, notamment, par le CCA, Centre de Communication Avancé, de Bernard Cathelat qui recense ainsi 19 styles de vie classés en trois grandes catégories : les Confiants, les Corsaires et les « Marco Polo ».
Choix d’écriture en fonction du socio style d’appartenance
Les premiers, les « Confiants« , qui correspondent à 41 % de la population sont de nature prudente et fidèles à des valeurs sûres. Si un auteur appartient globalement à cette catégorie, il aura tendance à ne choisir d’écrire que sur les thèmes et dans le style de ce qui fait les succès d’édition du moment. Si donc c’est la romance, va pour la romance.
Les seconds, les « Corsaires« , qui correspondent à 25 % de la population, sont des anticipateurs ou des spéculateurs. Ils sont à la recherche du « bon coup » et cherchent à « coller » au plus près des tendances éditoriales à venir. Plus que d’autres, ils sont à l’affût de ce qui fera un bestseller quitte à heurter les sensibilités des temps présents.
Les troisièmes enfin, les « Marco Polo« , près de 34 % de la population, sont à la fois méfiants vis à vis de l’existant, en tout cas, volontiers critiques, et sensibles à la nouveauté, sans pour autant s’y jeter à corps perdu. Pierre Bayard dans son essai sur « Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ? » résume bien la problématique de cette dernière catégorie quand il écrit :
Si les voyages de Marco polo rappellent la part de fiction qui s’attache à tout récit de voyage, ils posent aussi la question de la limité entre voyage et non voyage.
Notons qu’évidemment, on ne saurait ramener tous les styles de vie à ces trois grandes catégories. D’ailleurs , si on ne s’intéresse qu’à elle, au-delà de celles-ci, la population française peut aussi être répartie en cinq grandes mentalités : les décalés, les rigoristes, les égocentrés, les matérialistes et les activistes.
Bref, on écrit selon ce que l’on est et il est important de bien se connaître avant de se lancer dans tout travail d’écriture.
Quels critères de choix pour bien choisir son genre littéraire

Sans se laisser aller à de profondes réflexions sur soi-même, on peut tout simplement se contenter, pour ce faire, de prendre le temps de se demander à quoi on marche, comment on aime écrire ou communiquer et, encore plus simplement, de quel temps et de quels moyens on dispose. Commençons par cette dernière interrogation.
De quel temps et de quels moyens dispose-t-on pour écrire ?
Cette première approche, basique, de soi-même est fondamentale. On peut se prétendre futur écrivain et ne jamais prendre le temps nécessaire pour, ne serait-ce, écrire une page de fiction ou de réflexion. Les faits parlent alors d’eux-mêmes, l’envie d’écrire est bien là, puisqu’on y pense toujours, ou presque, mais elle est, en réalité, fictive car elle ne prend jamais forme.
Même constat pour ce qui est des ressources à mettre en œuvre pour écrire. Il faut du temps, mais aussi un peu de moyens. Au moins un ordi et l’habitude de s’en servir. Sans parler d’une bonne bibliothèque. Au moins, minimale. Tout auteur est aussi un lecteur. Hors lire, c’est un budget. Tout n’est pas sur internet et internet peut être trompeur. Et ce n’est pas tout. Pour écrire, il faut aussi disposer d’un espace. Au moins temporaire.
Si on n’a jamais le temps d’écrire et qu’on n’a rien pour le faire, il vaut peut-être mieux envisager de faire autre chose.
Qu’est-ce qui suscite l’envie d’écrire ?
Quand on aborde ce point, on aborde la question fondamentale de ce qui nous inspire ou pas. De ce qui est inspirant, pour soi, bien sûr ! Suivant ce que l’on est, on est sensible, par exemple, à la nature, aux exploits sportifs, aux marques de convivialité, aux beaux arts, etc.
C’est ce qui fait qu’on peut rester totalement imperméable à un beau match de rugby ou de football et être pressé de passer à autre chose ou être prêt à s’installer pendant des heures devant une œuvre d’art remarquable qu’il s’agisse d’architecture ou de peinture.
D’évidence, on ne peut pas écrire sur ce qui, a priori, n’inspire rien. Cependant, un auteur professionnel peut y parvenir. Mais dans ce cas, il saura trouver dans chaque sujet ce qui est inspirant pour lui.
Si par exemple, on lui demande d’écrire sur ce qui fait l’intérêt d’un hôtel avec spa dans la baie de saint Malo, il saura mettre en avant ce qui fait son côté inspirant et le différencie de tous les autres hôtels de la région qui dispose du même équipement. En l’occurrence, peut-être, les mânes du commandant Charcot et de son équipage.
Quel style d’écriture adopter ?
D’une manière générale, on peut écrire comme on le veut. Il n’y a finalement pas de règles en la matière. Céline a été un des premiers à montrer qu’on pouvait le faire sans que ça nuise à l’expression de grands sentiments et de grands idéaux.
D’autres, les oulipiens, pour ne pas les nommer, se sont amusés à écrire en s’imposant des règles plus ou moins absurdes. Pour la beauté du geste et faire la preuve de leur virtuosité. L’un d’entre eux a même réussi à décrocher, il n’y a pas si longtemps, le sélect prix Goncourt.
Au fond, l’arbitre en la matière, c’est le lecteur. Comme il se trouve que lecteur d’aujourd’hui est habitué à toutes sortes de formes d’expression, la télévision, les réseaux sociaux, entre autres, sont passés par là, bien des formulations sont admises. Cela dit, suivant le style adopté, on privilégie naturellement tel ou tel lectorat.
Quel genre littéraire choisir pour écrire ?
D’emblée, commençons par dire qu’il n’y a pas vraiment de genre littéraire meilleur que d’autres. Ce qui satisfera tous ceux qui sont sensibles à l’esprit du temps. Il n’en a pas toujours été ainsi. Il y a eu des époques où seul comptait l’art poétique et pour lesquelles le roman était une forme dégradée d’écriture.
On peut au moins mettre au crédit du monde moderne, la liberté qui y règne dans les modalités d’expression et rarement vue à l’échelle des temps historiques. Ce qui donne la possibilité à chacun d’écrire selon ce qu’il ressent profondément, dans la forme qui lui convient le mieux, et il a largement le choix, avec pour seules limites celles que lui impose la morale en vigueur. Ecrite ou non, il y en a toujours une.
Et pour encore plus de liberté, l’autoédition, en hausse constante, est le tremplin idéal pour donner forme à toute envie d’écrire sans se laisser intimider par quelque diktat éditorial que ce soit. Que ce diktat soit un diktat lié au contenu, ou ce qui est loin d’être négligeable, à la forme. A partir de là, les occasions pour promouvoir son livre ne manquent vraiment pas. Les concours d’écriture, les salons littéraires ou les foires aux livres, les prix en tout genre, foisonnent et chacun peut y trouver son compte pour peu qu’il veuille bien y consacrer un peu de temps.
Bref, les temps n’ont jamais été autant favorables à l’écriture. Les chiffres du secteur, que ce soit ceux du secteur de l’édition classique ou ceux de l’autoédition, le montrent d’ailleurs très bien. Et quand on sait tous les bienfaits que l’on peut attendre de l’écriture du seul point de vue du bien être moral, on aurait bien tort de s’en priver.