L’automne est une saison d’hyperactivité dans le monde de l’édition. C’est la grande saison des prix littéraires. Et les enjeux sont tels qu’elle se prépare longtemps à l’avance. Tous ses acteurs sont donc très tôt sur le pont. Auteurs susceptibles d’être primés, éditeurs et libraires soucieux de leurs marges commerciales, lecteurs perdus au milieu des flots de la production littéraire, tous attendent avec impatience la désignation du maître livre. Celui qui va rapporter gros. Celui que tout lecteur qui se respecte doit avoir, même s’il n’a pas l’intention d’en lire plus que quelques pages. Avec l’émergence d’une véritable industrie du livre, les prix littéraires sont devenus incontournables. Mais que sont-ils réellement ? Qu’est-ce qui en fait la valeur ou la non valeur ?
Qu’est-ce qu’un prix littéraire ?
Une vieille tradition
C’est la première question à se poser. Un prix littéraire est une récompense attribuée au livre ou à l’œuvre d’un auteur par un jury de personnalités ou de lecteurs. L’intention n’est pas nouvelle. Elle remonte loin. Au XIVème siècle très précisément avec la multiplication des concours floraux, autrement dit des concours de poésie.

Certains d’entre eux ont passé les siècles avec succès. Il en est ainsi des jeux floraux de Toulouse. Ils ont été crée en 1323 par sept troubadours et leurs prix sont toujours décernés chaque année depuis cette date.
Leur cadre a bien évolué. Ils sont administrés par l’Académie des jeux floraux instituée par Louis XIV en 1694 et sont hébergés dans le très bel hôtel renaissance d’Assézat à Toulouse.
Elle n’est évidemment pas la seule société savante à y être hébergée. De plus, l’hôte est aussi le siège de la fondation Bemberg dont il abrite les très belles collections d’art. Lors d’une visite à Toulouse mérite un détour et à défaut, si on est fan de poésie, mais pas que, on peut toujours s’inscrire à l’un des concours des prochains jeux floraux.
Une tradition renouvelée à partir du XVII ème siècle grâce à l’Académie française
Avec le temps les prix littéraires prennent leur essor. Premier facteur de cet essor, le besoin de commémoration. C’est dans cet esprit que s’inscrivent les premier prix décernés par l’Académie française. Son premier lauréat est une lauréate. Il s’agissait d’un concours d’éloquence et il fut remporté pour la première fois en 1671 par Mlle de Scudéry.

Le sujet fixé par Guez de Balzac était rien moins qu’ardu. Il fallut à Mlle de Scudéry bien de l’éloquence pour disserter sur « De la louange et de la gloire ; qu’elles appartiennent à Dieu en propriété, et que les hommes en sont d’ordinaire usurpateurs. » En tout cas, on peut l’ajouter sans peine à la liste des premières femmes de lettres françaises commencée au XII -ème siècle avec la grande poétesse Marie de France.
En tout cas, c’est en retenant l’idée de fondation formalisée par Guez de Balzac que quelques siècles plus tard, en 1903, les frères Goncourt ont créé leur célèbre prix. Mais à l’époque, ils ne pouvaient imaginer ce que serait sa trajectoire. Quoiqu’elle fut loin de passer inaperçue et suscita très vite des réactions.
Essor des prix littéraires avec le prix Goncourt
Indiscutablement, il y a un avant l’institution du Goncourt et un après. Avant, il y a quelques prix ou concours d’éloquence qui se battent en duel. Après, c’est le raz de marée. La faute aux frères Goncourt, Jules (1830-1870) et Edmond (1822-1896). Le prix est crée par testament par Edmond en 1896, mais le premier prix ne fut décerné que le 21 décembre 1903. Son but est de récompenser le meilleur ouvrage d’imagination en prose, paru dans l’année. Autrement dit, à un roman.
John Antoine Nau, premier lauréat Goncourt
Le premier à qui il a été décerné, presqu’en catimini, il faut bien le dire, est John Antoine Nau pour son roman « Force ennemie ». Le jury qui comprend quelques célébrités du monde des lettres de l’époque tels que Joris-Karl Huysman, Octave Mirbeau ou Léon Daudet l’a désigné à la fin d’un dîner qui a eu lieu le 21 décembre 1903, chez Champeaux, place de la Bourse, à Paris. Le restaurant n’existe plus aujourd’hui. Les dîners emblématiques chez Drouant, place Gaillon, ne commenceront qu’à partir d’octobre 1914.
Le roman de John Antoine Nau n’eut peut-être pas tout le succès qu’il aurait mérité, mais en tout cas il a su inspirer bien des décennies plus tard le talentueux Cédric Meletta qui en a fait le thème de son deuxième roman paru en 2022, « Le meilleur que nous ayons couronné » qui est une invitation à redécouvrir un auteur injustement méconnu.
A partir du lancement du prix Goncourt, la fièvre des prix littéraires s’empare de la République des lettres. Les jaloux, les envieux, les contestataires se déchaînent ! Du moins, on peut le penser. Quoi qu’il en soit, Femina, Renaudot, Interallié, etc. naissent dans la foulée. Aujourd’hui, on décompte près de 2000 prix littéraires décernés en France.
Quels sont les prix littéraires les plus importants en France ?
Les « big six » des prix littéraires
Ils sont au nombre de six. Ce n’est pas faire injure à tous ceux qui ne font pas partie de cette « short list« , c’est simplement reconnaître un état de fait. Ces six là sont importants parce que leur attribution constitue à chaque fois un évènement qui dépasse largement les limites de l’Hexagone.
On en parle longuement dans les semaines qui la précède, on en parle tout aussi longuement dans les semaines qui suivent. Avec eux, c’est quasi la France dans ce qu’elle a de plus littéraire qui s’exprime. Que ce soit pour consacrer un écrivain français ou un écrivain étranger. Qu’il soit conformiste ou iconoclaste. Et d’une certaine façon, on peut dire qu’aucun talent littéraire d’envergure, à l’aune de leurs canons ou préjugés, ne semble pouvoir leur échapper.
Origines et quelques spécificités de chacun des prix faisant partie des « big six »
Le prix Goncourt, 1903
Le Goncourt, on vient de l’évoquer, c’est le plus prestigieux de tous. Il est décerné à un romancier d’expression française par les « Dix ». Faire partie du jury Goncourt, est d’ailleurs une autre forme de consécration tout aussi importante que l’attribution du prix lui-même.
Une fois élus par leurs pairs, les membres du jury prennent chacun place à l’un des dix « couverts » libéré par le départ de l’un d’entre eux. Comme pour les fauteuils à l’Académie française, également numérotés.

Départ qui est obligatoire passé un certain âge, à la différence d’avec l’Académie française où les académiciens sont réputés immortels. Limite fixée à 80 ans jusqu’à il y a peu, mais que les académiciens Goncourt, dont quatre d’entre eux ont passé cette limite, viennent de repousser à 85 ans. Eux aussi sont hantés par la perspective, ou l’envie, de devenir Immortels à l’instar de leurs collègues, ou concurrents, de l’Académie française.
Notons, en outre, que les « Goncourt » ne sont pas non plus à l’abri d’éventuels impératifs éditoriaux dictés par les maisons d’édition auxquelles ils peuvent être liés. En tout cas, les sévères reproches qui ont pu leur être adressés par Judith Bouilloc, autrice spécialisée dans la littérature pour la jeunesse et lectrice attentive de tous les « Goncourt », à l’occasion de leur choix d’attribuer en 2024 leur prix à Kamel Daoud, peuvent le laisser penser.
Cette attitude critique à l’égard du célèbre prix n’est pas nouvelle. On peut même dire qu’elle lui est consubstantielle et qu’elle constitue sans doute la principale raison à l’émergence des autres prix figurant dans la liste des big six et à la multiplication des prix décernés par l’Académie française.
Le prix Femina, 1904
Sans prix Goncourt, il n’y aurait pas eu de Prix Femina. Tout part de la revue féminine la Vie heureuse. Sa création remonte à 1902 et a été impulsée par la maison d’édition Hachette. La revue mensuelle est dirigée par Caroline de Brouteilles. Elle s’adresse plus particulièrement aux femmes actives et indépendantes.
Myriam Harry, première lauréate du Femina
Elle compte notamment la grande poétesse Anna de Noailles parmi ses rédactrices. En 1904, toute la rédaction de la revue est outrée par la décision du jury Goncourt de ne pas attribuer son deuxième prix à la romancière Myriam Harry, dont elle juge le roman « La conquête de Jérusalem » bien plus digne d’être récompensé que celui de Léon Frapié, intitulé « La maternelle ».

Le fait est que les Goncourt de l’époque ne voient pas forcément d’un bon œil l’irruption des femmes dans la sphère littéraire. Ils peuvent même être tentés de ne voir en elles que des pintades, selon l’expression de l’un des critiques littéraires en vogue, incapables de juger quoi que ce soit dans ce domaine.
Ambiance, ambiance ! Les Femina, ou plutôt Vie Heureuse, à cette époque, décerneront donc leur premier prix, en janvier 1905, à l’autrice, Myriam Harry, écartée par les Goncourt.
Et cela, alors même que dans le même temps beaucoup d’entre elles, comme Anna de Noailles, entrent en force dans la république des lettres et contribuer à renforcer un courant de femmes de lettres de plus en plus conséquent et remarquable.
Fort heureusement, les temps ont bien changé. Aujourd’hui le Femina, c’est un prix attribué par jury exclusivement constitué de femmes, douze exactement, écrivains ou journalistes. Quant aux prix décernés – il y a plusieurs Femina – chaque année, ils sont attribués aussi bien à des hommes qu’à des femmes. L’essentiel étant que leur roman soit capable de générer une « émotion pure ».
Le grand Prix du roman de l’Académie française, 1914
Prix Goncourt, prix Femina, ç’en est trop pour la vénérable institution. Elle crée donc à son tour, en 1914, un prix pour les romans. Le grand prix du roman de l’Académie française. Jusqu’alors, le roman n’avait pas l’heur de lui plaire, elle lui préférait le théâtre et la poésie. L’un et l’autre beaucoup plus digne d’un vrai écrivain.
Le roman étant considéré par elle presque comme un genre mineur. Seulement voilà après le passage des hussards de la République, ces instituteurs et ces professeurs chargés par Jules Ferry d’alphabétiser les campagnes et le peuple, d’une manière générale, les français se mettent à lire. Et à lire quoi ? Mais des romans, bien sûr ! De préférence à des poèmes et à des pièces de théâtre plutôt réservés à une certaine élite.
Paul Acker, premier lauréat du grand prix du roman de l’Académie française
Pour garder la main, en quelque sorte, l’Académie française suit donc le mouvement. Elle décernera son premier grand prix du roman à Paul Acker (1874-1915) pour l’ensemble de son œuvre. Comme bien souvent pour un prix littéraire, les circonstances ont joué en sa faveur. L’époque est patriote, il est né à Saverne, ville allemande de 1871 à 1918, et meurt en service commandé à Moosch repris aux allemands en 1914. Bref, on est en plein dans la symbolique.
Le prix Renaudot, 1926
Là aussi, comme pour le prix Femina, on crée un crée un prix parce qu’on n’est pas content de ce que fait, ou ne fait pas, le jury du prix Goncourt. Au milieu des années 20, ce dernier est devenu un évènement journalistique. Les journalistes se pressent donc autour du restaurant Drouant pour connaître au plus vite le lauréat choisi par les Dix.
L’attente peut être longue, pas seulement à cause du dîner, et les romans sélectionnés pas forcément du goût des journalistes présents. Alors pour s’occuper et affirmer leur prééminence dans la république des lettres, dix d’entre eux décident de constituer à leur tour un jury pour choisir le meilleur roman de l’année à leurs yeux et qui n’a été récompensé par aucun autre prix.
Armand Lunel, premier lauréat du Renaudot
Et comme ce sont des journalistes, ils baptisent leur prix, prix Théophraste-Renaudot, fondateur du journal La Gazette. Leur premier lauréat sera un professeur de lycée, Armand Lunel, pour son ouvrage « Niccolo-Peccavi, l’Affaire Dreyfus à Carpentras ».
Cela dit, le prix Renaudot, pour faire court, même s’il fait incontestablement partie des big six, n’est pas lui-même exempt de toute critique. Décidément ! Il arrive qu’on dise de lui que c’est d’abord « le prix des amis ». Parce que apparemment bien connaître les membres du jury, ça aide beaucoup pour être primé. Et c’est facile, ils sont élus à vie, ça laisse donc le temps.
Un prix qui n’est malheureusement pas à l’abri des critiques : l’affaire Gabriel Matznef de 2013 et l’affaire Marco Kostas de 2018
Néanmoins, hors mis quelques choix qui ont pu sembler un peu litigieux sur le moment. Quelque fois à juste titre, notamment quand le prix a été décerné en 2013 à Gabriel Matzneff dans la catégorie essai. Pas très judicieux.
D’autre fois, de manière incompréhensible, comme lorsque le roman de Marco Koskas, « Bande de Français », a été sorti de la liste des lauréats potentiels parce qu’il avait été autoédité. Les libraires n’ont pas aimé.

A ce propos, le commentaire du syndicat de la librairie française (SLF) vaut la peine d’être cité. Selon lui, en effet, en conservant le titre dans sa sélection :
Le jury rend un bien mauvais service à l’auteur lui-même, aux libraires et donne un signal inquiétant pour l’avenir de la création et de la diffusion du livre.
Pour Marco Kostas, la cause est entendue :
Il s’agit d’un chantage et d’un diktat scandaleux.
Marco Kostas, un écrivain confirmé qui se tourne vers l’autoédition
Ecrivain franco israélien, en 2018, Marco Kostas n’en est pourtant pas à un coup d’essai. Il a publié son premier roman, Balace Bounel, en 1979. Bien reçu par la critique, il lui vaut le prix du premier roman la même année.
Depuis, il a publié 16 livres dont deux autoédités. Parmi ses éditeurs, on trouve Ramsay, Grasset, Calmann-Lévy, J-C Lattès, Laffont, Julliard, la Table ronde et les éditions La baleine.
« Bande de Français » qui raconte l’émigration récente de juifs français en Israël, son premier ouvrage autoédité, est son quinzième roman. Son dernier roman publié, « Toutes les femmes ou presque » a aussi été autoédité. On trouve l’un et l’autre sur toutes les plateformes spécialisées telles celles, entre autres, d’Amazon, de la Fnac ou encore de Cultura ou de Decitre.
Le prix interallié, 1930
Et bis repetita ! C’est parce que des journalistes habitués du cercle Interallié attendaient là les résultats du Femina qu’ils ont fini par créer leur propre prix suivant en cela ceux du Renaudot. Le cercle Interallié, c’est très, très chic.

Il a été fondé à Paris, en 1917, par l’élite de l’élite et fait partie des cinq grands cercles très fermés et très influents où il est de bon ton, ou très utile, de se faire admettre quand on occupe de hautes fonctions privées ou publiques. Mais, bon, si on parvient à y faire une conférence, on peut quand même y être admis pendant six mois.
En tout cas, il est installé dans les splendides locaux d’un hôtel particulier acquis, en 1919, auprès de Henri de Rothschild. On est là en bonne compagnie que d’aucuns néanmoins jugent parfois bien désuète. Mais sa terrasse, l’été, au cœur de Paris et au bord d’un parc de 4500 m2, vaut bien tous les sacrifices.
André Malraux, premier lauréat de l’Interallié
Le premier lauréat du prix Interallié a été André Malraux pour son roman « La voie royale« . Les mauvaises langues disent de ce prix qu’il est misogyne, car très peu de femmes en ont été finalement les lauréates, de même que sous la coupe des éditions Grasset. Pour cette raison, certains vont jusqu’à dire qu’on ne devrait pas parler du prix Interallié mais plutôt du prix Intergrasset.
Le fait est que plus de la moitié des romans récompensés ont été publiés par cette maison d’édition. Mais depuis quelque temps, sur l’un et l’autre point, les choses ont l’air de changer. Cela dit, comme l’Interallié est le dernier prix de la saison et qu’il ne peut être attribué à un auteur déjà lauréat d’un prix, c’est un peu aussi le « prix de la repêche ». On ne s’en plaindra pas.
Le prix Médicis, 1958
C’est le petit dernier des grands prix littéraires et il n’a pas d’histoires. Hors mis celles de ses fondateurs, Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux. La première est née en Russie en 1904. Elle s’en échappe quand elle devient soviétique grâce à un bel et riche italien qui l’enlève à Moscou. Elle a plus de chance que la belle Lara, maîtresse du Docteur Jivago, roman inoubliable de Boris Pasternak et qui disparait dans les remous de la révolution bolchévique.

Comme elle vit entre sa résidence italienne et sa villa parisienne, elle finit par faire la connaissance de Jean-Pierre Giraudoux, le fils de Jean. Ce dernier, un peu touche à tout de la république des lettres, a un projet de prix littéraire. Cela tombe bien, elle a essayé d’en créer un aussi, la Cote d’amour, avec Claude Edmonde Magny, rédactrice à la revue Esprit. Manque de chance ou manque de sens commercial, le prix n’a pas pris.
Avec Jean-Pierre Giraudoux, c’est du sérieux. Le prix veut s’attacher à distinguer les jeunes talents et s’inspire de la villa Médicis. Du moins, on peut le supposer. En tout cas, les ambitions sont similaires. Bingo ! Cette fois, pour Gala Barbisan, c’est le jackpot ! Le prix Médicis s’impose et à un point tel qu’on en crée deux autres dans les années qui suivent, le prix Médicis étranger en 1970 et le prix Médicis essai en 1985.
Claude Ollier, premier lauréat du Médicis
Quant au premier lauréat du prix Médicis, il s’agit de Claude Ollier pour son roman « La mise en scène ». On a dit plus haut que le prix Médicis est un prix sans histoires. Pas tout à fait quand même. A cause, une fois de plus, du Femina. Non pas qu’il ait été déterminant dans la création du prix, comme on l’a vu, mais tout simplement parce que c’est lui règle le jour de l’attribution du Médicis. A l’origine, il était attribué le même jour que le Femina, désormais, c’est soit deux jours avant, soit deux jours après.
Notons enfin qu’avec Claude Ollier, pour le jury du Médicis, ce fut une bonne pioche. A la suite de ce prix, Claude Ollier se mit entièrement à l’écriture et écrivit pas loin de 50 ouvrages dans la mouvance du nouveau roman. Il n’en reste pas moins un peu méconnu et n’obtint pas d’autre prix que le prix Médicis. A supposer qu’il l’ait voulu.
Multiplication des prix littéraires
Des sélections d’ouvrages par les Big Six toujours critiquables
A la suite des big six ou simultanément, les prix littéraires se sont multipliés. On en comptabilise aujourd’hui près de 2000. D’abord et avant tout, parce qu’il y a toujours moyen de critiquer le, ou les, choix de leur jury respectif. En cause, la qualité de leurs membres. La critique est traditionnelle.
Comme ils font partie du sérail éditorial, qu’ils sont, ou trop ceci ou pas assez cela, il y a naturellement place pour d’autres jurys, composés, par exemple, uniquement de lecteurs. Forcément, plus objectifs. Du moins, c’est ce qu’on veut croire.
Prix des lecteurs
De là, des prix comme le prix des lecteurs du Livre de Poche, de Folio, J’ai lu, de la Maison du livre, du journal Elle, etc…
Mais ce n’est pas tout. L’attribution des prix faisant partie des Big Six constitue un évènement essentiellement parisien. Les régions, les départements, les communes, les pays n’ont pas voulu être en reste.
Prix de collectivités territoriales
De là, aussi, les petits prix territoriaux. Citons, entre autres, le prix littéraire de la Région sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dont la spécificité est, en plus, d’être attribué par un panel de lycéens et d’apprentis. Le prix littéraire devient alors prix éducatif.
Dans le même esprit, on peut également citer le tir groupé de la région Nouvelle Aquitaine qui soutient rien moins que 4 prix : le prix Renaudot des lycéens, le prix de livre en livre, le prix François-Mauriac et le prix Lacouture.
Pour en savoir plus sur ces prix, on ne peut que conseiller de se rapprocher des collectivités en question pour voir ce qu’elles font dans ce domaine. Ajoutons que la plupart du temps, les médiathèques ou bibliothèques dont elles assurent le fonctionnement aiment aussi attribuer des prix.
Prix d’entreprises ou de fondations d’entreprise
Et ce n’est pas tout, d’année en année, la tendance à la création de prix littéraires s’affirme. Si les lecteurs revendiquent leur place dans les jurys au nom de « et nous et nous », si les régions y voient une manière de gratifier leurs enseignants et leurs bibliothécaires, les entreprises et leurs fondations y voient l’occasion de pratiquer à peu de frais une politique de RSE.
On a donc ainsi le choix entre le prix du livre de Cogedim club, le prix du roman de la Fnac, le prix du livre Inter, etc…
Mobiles financiers des grands prix littéraires
Certes on peut toujours critiquer les choix des jurys des grands prix littéraires. La critique est facile. C’est oublier que derrière les prix littéraires, il y a d’abord une industrie qui pèse lourd d’un point de vue économique. Si elle « tousse », la création littéraire en pâtit nécessairement.

Ce n’est un secret pour personne qu’elle a besoin de locomotives pour financer les risques de « bouillon » qu’elle prend en publiant des auteurs inconnus. Et cet aspect est évidemment plus déterminant que les retombées en termes d’image, toujours aléatoires, qu’on peut éventuellement en attendre quand on se situe en dehors de celle-ci. Money is money.
Un prix littéraire attribué par l’un ou l’autre des jurys faisant partie des big six s’inscrit donc toujours dans une démarche commerciale pour les éditeurs, de même que pour les libraires. Quoi qu’ils en disent. En effet, il est de leur intérêt bien compris de faire en sorte que leurs « poulains » fassent au moins partie des différentes sélections. D’où des stratégies et des pratiques éditoriales en conséquence.
Les chiffres clés des grands prix littéraires
Pour le comprendre, rien ne vaut quelques données chiffrées pour se fixer les idées. Gardons en mémoire que le prix d’un livre se répartit en gros de la manière suivante : 8 à 10 % pour l’auteur, 14 à 15 % pour l’éditeur, 10 à 15 % pour l’imprimeur, 50 à 60 % pour le diffuseur et 34 à 36 % pour le libraire.
Montant des récompenses financières par grand prix littéraire
Notons également que pour ce qui concerne les auteurs être lauréat d’un des prix des Big Six ne donne lieu quasiment à aucune récompense sonnante et trébuchante. Le Goncourt donne royalement 10 euros, Le Médicis, 1000 euros, c’est déjà ça, et les quatre autres, tout simplement, 0.
Nombre moyen d’exemplaires vendus par grand prix littéraire
On l’aura compris, l’intérêt de n’importe lequel des six grands prix littéraires, c’est la manne financière qui tombe sur les différents récipiendaires fait du nombre de ventes qu’il occasionne. Qu’on en juge, le Goncourt, tout en haut du podium, pèse à lui seul entre 300 et 500 000 exemplaires vendus. Les autres, c’est moindre, mais c’est quand même tout à fait respectable, Le Renaudot, autour de 200 000, Le Femina, autour de 150 000, le Grand Prix du Roman, autour de 100 000, l’Interallié, autour de 50 000 et le Médicis, autour de 30 000.
Le calcul pour savoir ce qui revient à chacun est simple à faire. Mais, il reste sous évalué, surtout pour les auteurs confirmés. Etre lauréat du Goncourt, par exemple, mais cela vaut aussi pour les autres prix, ça booste aussi les ventes des autres livres du lauréat et les revenus annexes tirés de toutes ses participations à tel ou tel évènement.
Concentration du chiffre d’affaires éditorial sur la rentrée littéraire d’automne
Quand on sait de surcroît que près de 20 % du chiffre d’affaire du livre se fait pendant les trois quatre mois de la rentrée littéraire, on mesure sans peine l’importance de l’enjeu. Comme on peut l’imaginer, rien n’est donc laissé au hasard, ou presque.
Stratégies et pratiques éditoriales appropriées
Sans s’étendre sur cet aspect des choses, qui concerne les coulisses de chacun des prix, petits ou grands, d’ailleurs, il est évident que les résultats des études de marché, les objectifs de chiffre d’affaires à atteindre, le montant des budget promotionnels à mobiliser suivant le plan média, etc., sont des données qui peuvent faire mettre de côté les qualités littéraires des ouvrages et des auteurs en compétition.
Soyons, néanmoins, honnête et faisons preuve quand même d’un peu d’idéalisme. Quelles que soient ces données et leur importance, quelle que soit la méthode plus ou moins scientifique utilisée pour essayer déterminer le meilleur choix, celui qui rapportera le plus, les ouvrages qui arrivent à ce niveau, on pourrait presque parler de sélection naturelle, ont tous un minimum de qualités littéraires. Question d’image de marque, comme on peut s’en douter !
Un prix littéraire pour tous les genres littéraires
Puisque les prix littéraires, ça boostent les affaires, de l’édition s’entend, on aurait bien tort de s’en priver et donc de les décliner. Autrement dit, de les segmenter. Toutes les entreprises bien gérées font ça. Et donc, outre les prix littéraires territoriaux, de lecteurs ou d’entreprises, on a pratiquement autant de prix qu’il y a de genres littéraires.
Citons, notamment, pour quelques uns d’entre eux, le Grand prix de l’imaginaire pour la science fiction, Grand prix de littérature policière pour les romans policiers, Grand prix du jury d’Angoulême pour les bandes dessinées, le prix de littérature religieuse pour les ouvrages à vocation téléologique, Grand prix de l’académie nationale de cuisine, Prix de l’essai de l’Académie française, etc.
Le prix littéraire, un outil au service d’une stratégie auctoriale
Evidente pour les éditeurs, pour lesquels un prix littéraire est un moteur de croissance, une stratégie de développement fondée sur l’obtention d’un prix littéraire l’est aussi pour des auteurs cherchant à accroitre leur notoriété et tout ce qui l’accompagne dans le monde de l’édition.
Evidement, ce faisant, on s’éloigne de la création littéraire pure et on se rapproche, certains diront dangereusement, d’une production littéraire à but essentiellement lucratif. Cependant, sans aller jusque là, où l’étape ultime est le remplacement de l’auteur par une IA de dernière génération, qui fera tout aussi bien, voire même mieux, rien n’empêche de se mettre au diapason d’une époque.
C’est même plutôt recommandé. Pas la peine de se mettre à écrire à la façon des troubadours du XIVème siècle parce comme aime ça. Mieux vaut s’efforcer de coller aux thématiques du moment et chercher à y apporter son grain de sel. Une bonne analyse de ce qui paraît et de ce qui marche, les prix littéraires sont de bons indicateurs pour cela, peut être très utile.
Et si on veut faire les choses bien , on peut combiner cette recherche des tendances éditoriales avec l’expérimentation à peu de frais dans le cadre des non moins nombreux concours d’écriture ou appels à texte qui ressemblent à s’y méprendre à de petits prix littéraires. Manière de s’entrainer à composer le narratif qui va faire un tabac.
Quel avenir pour les prix littéraires ?
La réponse à cette question semble aller de soi. Trop d’intérêts sont en jeu pour que l’inflation de prix littéraires s’arrête. Elle peut tout au plus se ralentir ou « stagner » à un haut niveau.
On ne peut néanmoins s’empêcher de penser que trop de prix littéraires peut finir par tuer les prix littéraires. Ou les déconsidérer. D’ailleurs, cela expliquant peut-être ceci, on peut se demander ce qu’est un grand écrivain aujourd’hui et si les prix littéraires ne contribuent pas à sa disparition.
Il n’y a pas si longtemps encore, on savait, à coup sûr, ce qu’était un grand écrivain et on savait qu’il passerait les siècles comme classique. Aujourd’hui, il semble que concomitamment avec l’inflation des prix littéraires, il y ait eu une déflation du nombre de grands écrivains. Autrement dit, le prix littéraire, si grand soit-il, ne fait pas forcément le grand écrivain.
Et encore moins, peut-on ajouter, le nombre d’exemplaires vendus. Pour autant, le besoin de grands écrivains se fait toujours sentir.

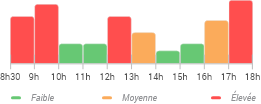

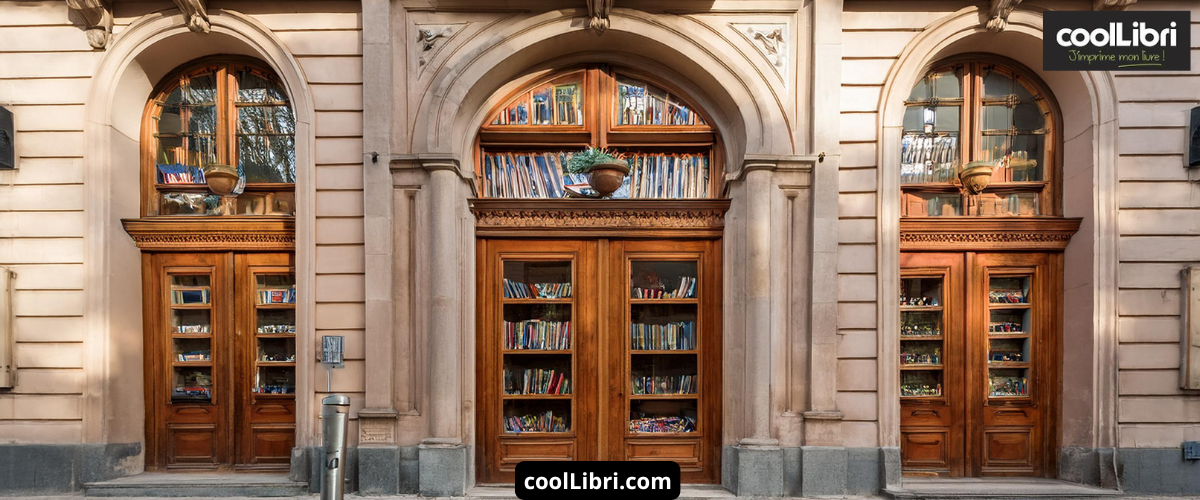
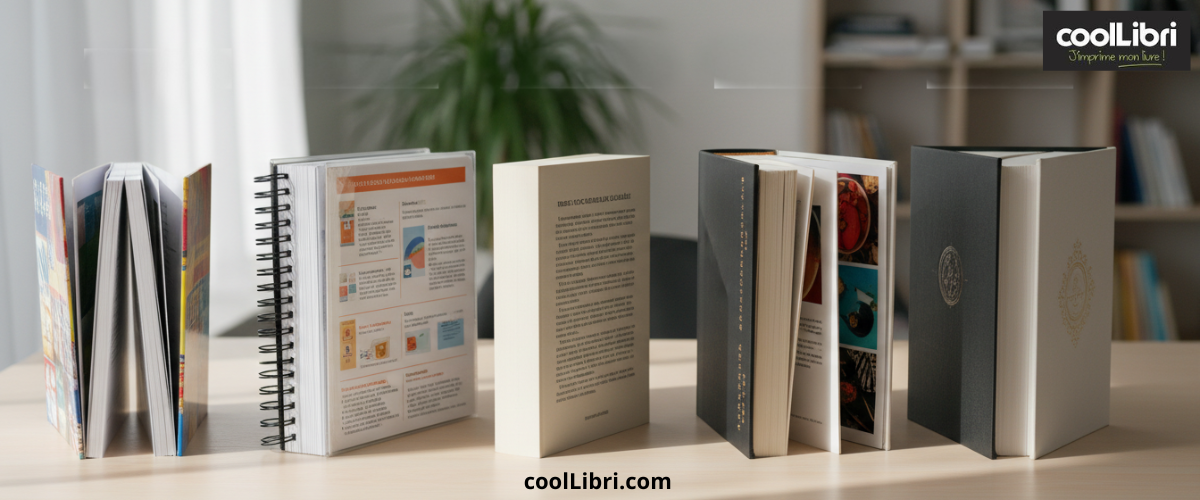
Je pense que l’IA fera de bons livres mais ne remplacera pas l’imagination et le vécu de l’être humain .